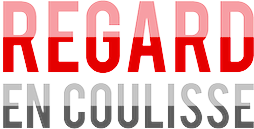Albert Cohen, vous avez commencé par faire des études de médecine, puis vous avez participé aux débuts de la radio libre. Parlez-nous du parcours qui vous a amené vers la production de spectacles musicaux...
J'ai vécu mon enfance et mon adolescence à Lyon. A partir de quinze ans, je gagnais mon argent de poche en faisant l'animateur dans des clubs de vacances. Je tombe alors sur un premier chef de l'animation qui est Richard Anconina, avant qu'il ne devienne acteur. Il était déjà passionné de théâtre et n'avait qu’une envie : monter des spectacles. On monte alors L'homme de La Mancha puis Starmania et ça me passionne. Dès mon adolescence, je suis piqué à l'exercice de la création et l'organisation d'un spectacle musical.
La radio vient ensuite...
En 1981, je suis en deuxième année de médecine. Un ami m'appelle et me dit que son frère a envie de monter une radio. Je me retrouve dans le premier cercle d'une radio lyonnaise, Radio Contact. Je suis animateur puis j'en prends la direction. En 1983, avec Pierre Alberti, on crée Radio Nostalgie. Mes années 80 sont donc consacrées à la radio. Je deviens chef d'entreprise, avec moins de temps pour faire de l'antenne mais je me garde un caprice : une émission hebdomadaire sur l'histoire des comédies musicales, que j’anime avec un chorégraphe lyonnais, Serge Piers. J'avais cet expert, et moi, j'étais l'animateur passionné.
Vous passez ensuite à la production...
En 1989, j'ai envie de produire de l'image. Je rencontre Dove Attia et on crée notre première boîte de production. On apprend le métier de producteur d'images mais je garde mon amour passionné pour la musique et le spectacle musical. En 98, Charles Talar m'appelle pour m'inviter à la générale de Notre Dame de Paris, qu'il produit. J'y vais et en sortant du Palais des Congrès, je fais une crise de jalousie. Je me dis : c'est ça que je veux faire ! Deux semaines après me vient l'idée des Dix Commandements.
A l'époque, je suis proche d'Elie Chouraqui car je produis son film Harrison's Flowers. Je lui propose la mise en scène des Dix Commandements. On va chercher Pascal Obispo qui réfléchit et revient enthousiaste avec la maquette de « L'envie d'aimer ». Et voilà la belle équipe, complétée par un Kamel Ouali que personne ne connaissait à l'époque.
Les Dix Commandements arrive au Palais des Sports en septembre 2000 avec le succès qu'on connaît : près de deux millions de spectateurs, deux Palais des Sports, trois tournées et un Bercy. On est porté par un phénomène surnaturel, on fait un gros hit avec « L'envie d'aimer » qui nous fait comprendre qu'on peut remplir des salles si le spectacle est précédé d'un tube. Avec Dove, on a l'intention de poursuivre la belle histoire et on enchaîne avec Autant en emporte le vent, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock, Le Magicien d'Oz (au Grand Rex) et 1789 les Amants de la Bastille et un cumul de six millions d'entrées sur l'ensemble de ces spectacles.
Vous produisez ensuite en solo ?
A la fin de 1789, on avait treize ans de production non-stop derrière nous, plus le fatal accident qu'on a connu au Palais des Sports. Dove décide de prendre une année sabbatique. J'en profite pour produire quelque chose qui me tenait à cœur depuis toujours : Mistinguett, reine des années folles - et je pousse la folie du projet jusqu'à jouer sur les lieux de l'histoire, au Casino de Paris. On a fait 188 shows dans un format nouveau pour moi, que je découvre, et je suis intimement convaincu que c'est la bonne direction. Je récidive avec Le Rouge et le Noir avec cette version « théâtre musical » plutôt que « grand dispositif, grande jauge », pour des raisons artistiques, émotionnelles. La dimension d'un théâtre de 1000, 1500 places permet la proximité et donc de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans un Palais des Sports.
Il y a également des raisons de coûts - évidemment plus modestes - et enfin, aujourd’hui, nous, producteurs, sommes à la recherche de la diversification de nos modes d'exploitation. Depuis Les Dix Commandements, tous nos spectacles se sont exportés sur plusieurs territoires et j'ai très vite constaté que le format technique est déterminant. On a du mal à imposer des grands formats car ce sont des spécificités françaises. On l'a fait parce qu'il fallait occuper l'ouverture du Palais des Sports et son plateau. On a livré des spectacles de ce format là parce que c'était adapté à la salle qu'on occupait. Ce n'était pas une volonté de départ, on naviguait à vue. Or le format « Broadway », comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire « théâtre », est le format qui s'exporte. Autant produire directement dans ce format là, ce sera plus rapide et plus efficace. Selon moi, le modèle Le Rouge et le Noir, est le format qu'on doit produire si on ambitionne un export plus large.
Depuis Mistinguett, on s'oriente vers une forme un peu plus théâtrale en format technique mais aussi dans l'écriture (avec des auteurs de livrets) et dans l'exécution, avec plus de musiciens live. Vous n'en aviez pas eu envie avant ?
Bien sûr que si. On part d'un principe absolu, c'est que la production d'un spectacle musical commence par l'écriture d'un livret. Et j'insiste sur ce point car force est de constater que tous les spectacles musicaux ne profitent pas d'un livret écrit sérieusement, hélas. Dove comme moi attachons une importance extrême à ça.
Et la prochaine évolution tendra vers quoi ?
Aujourd'hui, on est encore dans le théâtre à l'italienne. Le point de vue des metteurs en scène et du public est déjà très nouveau ,avec un modèle comme Le Rouge et le Noir et sa mise en scène adossée à cette imagerie sur des écrans mobiles. On va selon moi vers l'immersion totale et elle sera totale quand ce principe d'imagerie sera à 360°. Mais cette salle n'existe pas et je travaille sur le développement d'un projet de salle que j'ai appelée le Dream Arena. Ce sera une salle révolutionnaire qui permettra une immersion totale dans l'univers du show.