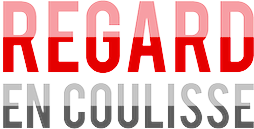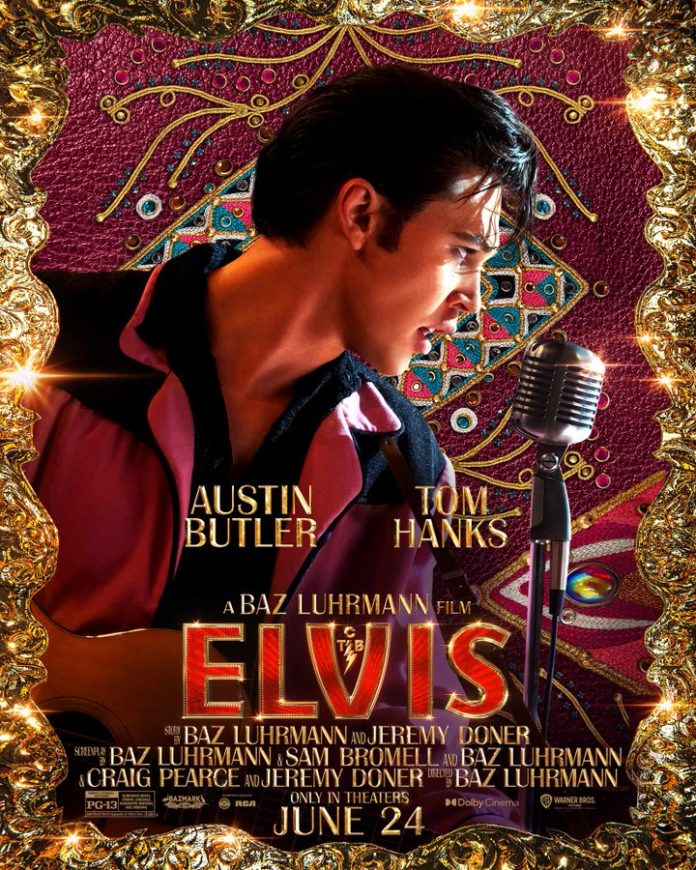Connu pour ses films grandioses tels que Moulin Rouge ou encore Gatsby le magnifique, le réalisateur Baz Luhrmann confirme une nouvelle fois son goût pour le spectacle, le spectacle, et encore le spectacle... quoi qu’il en coûte.
Pour le cinéaste, cela ne fait aucun doute : un bon spectacle s’obtient par la combinaison de rythmes et de mouvements. Ses choix de réalisation sont dynamiques, intelligents et, bien que le montage reste agressif, nous arrivons à respirer sur quelques plans joliment composés.
Ce n’est pas désagréable. C’est même divertissant, mais cela ne cache pas les lacunes d’écriture. Nous pouvons considérer que le problème majeur réside dans un scénario qui manque cruellement d’éléments solides pour composer une histoire.
 Bien évidemment, si l’on imagine un film sur Elvis Presley, nous pensons tout de suite à :
Bien évidemment, si l’on imagine un film sur Elvis Presley, nous pensons tout de suite à :
1/ des débuts difficiles ;
2/ un succès fulgurant ;
3/ une descente aux enfers.
Et c’est ce qu’on l’on voit.
Toutes les cases sont cochées, y compris la scène dans laquelle sa compagne le quitte, fatiguée de vivre avec un homme accro aux médicaments. Mais nous voyons venir ce moment de très loin, tout semble trop prévisible.
Certains diront : « Ce qui est intéressant, c’est la façon dont cela est montré. » Certes, mais le plus important n'est-il pas l'angle adopté pour raconter l'histoire ? Si le réalisateur avait prêté autant d’attention à structurer son scénario qu’il ne s’amuse à faire du zèle avec sa caméra, peut-être que les rebondissements auraient gagné en efficacité.
Le plus irritant reste cette façon de prendre le public par la main pour s’assurer qu’il suit correctement l’histoire. Le cinéaste nous a habitués – par exemple dans l’excellente série The Get Down (à voir sur Netflix) – à moins infantiliser le public, une habitude qui, n’ayons pas peur de le dire, est devenue une tare du cinéma d’aujourd’hui.
L’humain qui se rend au cinéma comprend les enjeux... humains. Tous les jours de sa vie, il est amené à jongler avec des émotions, des sentiments, des passions, pourquoi donc répéter à l'envi – parfois même après deux heures de film – qu’Elvis suit à tort les conseils de son manager en dépit des nombreuses mises en garde de sa femme, de sa famille et de ses amis ? Le public l’a compris dès le départ. Il aurait été intéressant d'apporter de la nuance dans cet élément dramaturgique.
 Notons que la façon dont le personnage de Tom Hanks manipule la famille Presley – notamment lorsqu’il suggère que la fonction de business manager devrait être assurée par le père, alors que ce dernier n’a aucune compétence en la matière – est un axe intéressant de l’histoire qui est délaissé ... et c’est bien dommage. Il serait certes fastidieux de montrer correctement à l’écran comment, par la flatterie et la subtilité des formules de langages qu’il utilise, le manager arrive à ses fins. Concrètement, cela aurait demandé un plus gros effort de réécriture dans une industrie où le temps est un luxe.
Notons que la façon dont le personnage de Tom Hanks manipule la famille Presley – notamment lorsqu’il suggère que la fonction de business manager devrait être assurée par le père, alors que ce dernier n’a aucune compétence en la matière – est un axe intéressant de l’histoire qui est délaissé ... et c’est bien dommage. Il serait certes fastidieux de montrer correctement à l’écran comment, par la flatterie et la subtilité des formules de langages qu’il utilise, le manager arrive à ses fins. Concrètement, cela aurait demandé un plus gros effort de réécriture dans une industrie où le temps est un luxe.
Il est quand même appréciable de noter la qualité de la bande originale, un aspect sur lequel les films de Baz Lurhmann ne déçoivent jamais. Soit un mélange respectueux de morceaux d'Elvis accompagnés de touches anachroniques. Mention spéciale pour l’ajout de drill – ce style de rap provenant de Chicago et aujourd’hui très à la mode – et particulièrement pour la participation de Doja Cat avec son titre « Vegas » qui surpasse haut la main les flows et les rimes d’un Eminem satisfaisant, mais dont le morceau composé pour le générique n’a rien de transcendant.
Les deux heures et trente-neuf minutes de film offrent malgré tout une jolie association de musiques et d’images qui ne saurait être totalement appréciée qu'en salle. C’est peut-être une chose que l’on peut concéder à ce film à grand spectacle qui justifie le fait de s’enfermer dans une salle noire – parfois non climatisée – en plein mois de juillet.