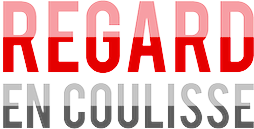S’il signe depuis quatre ans les adaptations françaises des spectacles de Mogador, Nicolas Engel est avant tout réalisateur de films musicaux. Fervent défenseur de ce genre cinématographique qu’il espère bien contribuer à populariser en France, il s’est confié à Regard en Coulisse.
De Grease à Ghost, de l’enthousiasme de Gillian Lynne à la dentelle de Chicago, Nicolas Engel nous fait découvrir l’envers du décor. Entretien sans sous-titres !
Vous réalisez depuis quinze ans des courts-métrages, dont beaucoup sont diffusés sur Canal+... et tous sont travaillés sur la forme de la comédie musicale. C’est pourtant un genre rare en France…
Totalement ! Cela reste éminemment marginal. Au cinéma, il y a tout juste un film par an, mais qui ne s’assume jamais vraiment comme tel. Rien à voir avec les États-Unis ! Ce qui est le plus flagrant, c’est que la comédie musicale, qui vient de l’opérette, est à la base, le genre populaire par excellence ; c’est La Mélodie du bonheur, Gene Kelly… mais il y a chez nous une espèce d’a priori. En France, cette tradition a connu son apogée dans les années trente, avec les films de René Clair notamment. Puis il y a eu évidemment Jacques Demy. Mais depuis, les films musicaux se comptent sur les doigts d’une main : Jeanne et le garçon formidable, Huit femmes, Agathe Cléry et les œuvres de Christophe Honoré. C’est vraiment un genre non identifié, comme s’il allait rebuter le spectateur, lui faire peur.
Pourquoi ce tel décalage avec les États-Unis ?
Possiblement car c’est un genre hyper-américain, avec des codes qui ne sont pas – ou plus – les nôtres. Dans les pays anglo-saxons, on étudie la comédie musicale tout au long du collège et du lycée. C’est une culture ancrée. Les Français ne l’ont pas ; ils n’ont pas les repères. Quand les films sont des adaptions de spectacles – Les Misérables par exemple –, le public français ne saisit pas, alors qu’aux États-Unis, tout le monde connaît les chansons de ce musical. Mais il y a des progrès, le marché est curieux, les productions moins frileuses. Le succès de La La Land n’y est sans doute pas pour rien. Et à mon petit niveau, j’essaye aussi d’y contribuer.
Pourquoi cette passion pour la comédie musicale ?
Très jeune, je me suis rendu compte que mes séquences préférées dans les films étaient les moments chantés. J’aimais que la narration soit portée par le chant. Mes parents m’ont aussi emmené voir des spectacles (Cats en 1989 au Théâtre de Paris, Peter Pan…). J’ai été totalement séduit par cet art. Comme dans l’opéra, la narration, si elle est portée par la musique, prend un style emphatique. Tout prend plus de puissance et laisse une empreinte plus forte dans l’imaginaire.
Même au cinéma ?
L’énergie du direct, avec l’orchestre et les interprètes, est évidemment impossible à retranscrire sur grand écran. Mais certains films y parviennent. Jacques Demy nous embarque totalement avec ses Parapluies. West Side Story ou La Mélodie du bonheur sont des adaptations formidables. J’ai la même émotion que dans une salle, bien plus parfois. Face à West Side Story par exemple, les images captées sont tellement iconiques, les angles de caméra si bien choisis pour saisir les mouvements de danse à la perfection, ou pour offrir des gros plans sur les visages des chanteurs, que je suis davantage touché.
Comment vous êtes-vous retrouvé adaptateur à Mogador ?
En 2016, apprenant que Stage Entertainment allait programmer Le Fantôme de l’Opéra, j’ai tout simplement contacté le théâtre. Je ne connaissais personne, mais je connaissais l’œuvre par cœur ! Adolescent, je l’écoutais en boucle, j’avais dévoré Gaston Leroux, j’étais incollable. Moi qui ne parlais alors pas un mot d’anglais, je l’avais traduite intégralement avec mon petit dictionnaire. L’œuvre d’Andrew Lloyd Webber est d’ailleurs pour moi la plus proche, la plus fidèle à celle de Leroux, et je rêvais que le show soit donné en français ; une évidence ! Les équipes de Stage m’ont répondu en m’envoyant une somme d’extraits à traduire en quinze jours ! A l’issue de plusieurs étapes, j’ai été choisi par Charles Hart, l’auteur original du spectacle. En fait, j’ai appris l’anglais en traduisant le Fantôme, et le comble, c’est que vingt ans plus tard, il a fallu que je recommence ! Malheureusement, chacun sait ce qui est arrivé (l’incendie du théâtre et l’annulation du show, N.D.L.R.), mais depuis, j’ai poursuivi ma collaboration avec Stage pour Grease, Chicago, et Ghost cette année.
Justement, comment travaillez-vous ?
C’est très différent selon les spectacles. Le travail dépend à la fois de l’œuvre et du rapport que l’on a avec elle. La première étape est de l’apprivoiser. Puis, comprendre comment elle est construite, quelles émotions elle produit, et comment elle s’y prend pour y parvenir. Je réfléchis alors : comment, en français, arriver au même effet, au même résultat ? C’est là toute la difficulté de l’adaptation : scène après scène, phrase après phrase, étudier la construction. Parfois il faut la conserver telle quelle, avec des rimes identiques, parfois il faut s’en éloigner totalement pour en restituer l’essence ; s’éloigner de la traduction littérale pour se rapprocher du sens de la phrase ou de la chanson.

Mais il ne faut pas oublier la mise en scène. Sur le Fantôme, Charles Hart, qui comprend et parle le français, me poussait à la créativité. Sur Chicago, cela fut plus difficile. Chicago est écrit de façon extrêmement fine dans le rapport du texte à la chorégraphie : c’est de la dentelle, tout est d’une infinie précision. J’étais loin de m’en rendre compte devant ma feuille blanche ! J’avais écrit dialogues et chansons tels qu’ils me semblaient sonner le mieux en français. Je n’avais pas perçu à quel point la mise en scène et les mouvements des artistes sont liés au texte. En changeant l’ordre des mots, les gestes ou les expressions des artistes ne correspondaient plus ! La phrase française avait exactement le même sens, mais ne collait plus du tout à la mise en scène. Tania Nardini (metteure en scène) m’a fait reprendre énormément de passages. En un mois, ce fut presque une réécriture quasiment en direct !
À l’inverse, j’ai vécu un moment exceptionnel lors des répétitions du Fantôme : l’immense Gillian Lynne, se rendant compte que mon texte ne coïncidait plus avec sa chorégraphie de « Mascarade », s’est tournée vers moi et m’a dit : « Tu sais quoi ? C’est Paris, je change tout ! » Pour la première fois depuis sa création, elle retouchait ce tableau qui a fait le tour du monde, adaptant ses mouvements à mon texte. Une création unique pour la France. C’était irréel.
Quelle fut la difficulté sur Grease ?
Une difficulté de taille : personne n’avait vraiment envie d’entendre Grease en français… Pour un adaptateur c’est le comble ! Pourtant, si tout le monde connaît les chansons, certaines sont narratives et indispensables à comprendre. Or, les traduire était impensable. Quant à avoir des dialogues en français et des chansons en anglais, cela revenait à casser tout le flux de la narration, à casser le rythme. Ce qui fait la valeur d’une comédie musicale, c’est justement le passage du parlé au chanté. Alors, avec le tandem avec qui je travaille à chaque fois, Dominique Trottein et Véronique Bandelier (respectivement directeur musical et metteur en scène résidents), on a fait au mieux en conservant les deux langues (couplets en français, refrains en anglais, N.D.L.R.).
Enfin, Ghost m’a réservé d’autres complications. La musique hyper-américaine ne se prête pas du tout à ce que des mots français se posent dessus. Les accentuations sont très précises. En outre, le vocabulaire est basique, car nous sommes dans un langage du quotidien. Mais ce qui fonctionne en anglais semble tout de suite idiot en français ; il a fallu ruser et éviter la traduction littérale. Les scènes de comédie, déjà brillamment écrites, ont été en revanche très amusantes et faciles à traduire.
Finalement, que répondez-vous à ceux qui estiment que c’est un sacrilège de traduire ?
Ceux qui s’offusquent que l’on traduise les comédies musicales sont les mêmes qui vont voir du Shakespeare en français et que ça ne dérange pas. Shakespeare en français, il n'en reste rien ! Tout est dans la forme. Pour revenir à ce que je disais au début, j’ai moi-même découvert la comédie musicale enfant, en allant applaudir Cats ou Peter Pan, joués en français. Ma passion est née à ce moment-là ! Si, comme le fait remarquablement Stage Entertainment, on veut populariser le genre, le faire aimer, et toucher un large public chez nous, il faut que les spectacles soient joués en français. Et pour tous  ceux qui souhaitent voir le spectacle dans sa langue originale – il doit y en avoir beaucoup dans les lecteurs de Regard en Coulisse –, c’est tout simple, il suffit de se rendre à Londres !
ceux qui souhaitent voir le spectacle dans sa langue originale – il doit y en avoir beaucoup dans les lecteurs de Regard en Coulisse –, c’est tout simple, il suffit de se rendre à Londres !
A noter : En janvier 2020, Le Fantôme de l’Opéra sera joué en version de concert au théâtre Saint-Denis de Montréal. Il s’agit de l’adaptation française de Nicolas Engel, prévue initialement pour Paris. Vingt dates exceptionnelles. Tous les renseignements sont ici.