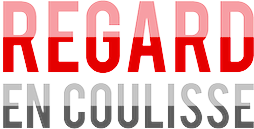Le public et les téléspectateurs vous connaissent, mais qui êtes-vous, Vinicius?
Mes origines sont multiples… Né au Brésil, de parents flamands, j’ai grandi à Toulouse. En parallèle de mes études scientifiques, je prenais des cours de chant. Pour être honnête, je n’avais alors aucune confiance en moi, et le chant m’a énormément aidé à traverser ces années particulières de l’adolescence. Après mon diplôme aux Beaux-Arts, en design écologique, j’ai réalisé que mon année la plus heureuse était celle où je partageais mon temps entre les arts plastiques et les arts scéniques, avec mon groupe de pop-rock. Cependant, si j’adorais chanter, dès qu’il était question de scène, de performance, j’étais tétanisé à l’idée d’être vu, jugé, entendu. L’été 2014, j’ai donc pris une décision radicale : monter à Paris et me former professionnellement en chant, et plus largement en comédie musicale. Tout s’est fait en quinze jours : J’ai quitté le Sud, intégré la section comédie musicale des cours Florent et suis reparti de zéro.
Les rôles n’ont pas tardé pour vous, en France, même en Angleterre avec Henri V...
Dès la fin de ma première année en effet, j’ai rejoint Le Secret de Fabula, un musical pour enfants. Puis ce fut Hercule dans une histoire à la grecque, grâce à la confiance de Fabien Gaertner. Les projets se sont alors enchaînés : Next Thing You Know (avec l’AMTlive ) et bien sûr, Saturday Night Fever. J’avais passé l’audition sans réel espoir, et Bruno Berberes m’a donné ma chance, avec Roberto Ciurleo, déjà ! Ce fut une expérience incroyable. Cinq mois d’un show immense. J’ai poursuivi avec la tournée de Je suis Fassbinder, une pièce contemporaine de Falk Richter et Stanislas Nordey. Du théâtre public pur, bien loin des Bee Gees ! Nous l’avons repris plus tard au Rond-Point. Quant à Henry V, j’ai la chance d’être parfaitement bilingue depuis tout petit. Mon profil sur Spotlight, la plateforme de casting anglo-saxonne, a été repéré par l’Antic Disposition Company. Je me suis retrouvé « connétable de France » dans cette adaptation de la pièce de Shakespeare, en mode chorale début du siècle. C’était une mise en abyme du théâtre, où des soldats blessés de la Première Guerre mondiale, isolés dans un hôpital de campagne, se mettent à jouer Henry V, pour faire oublier l’horreur de la guerre. Du théâtre dans le théâtre. Nous avons rempli les cathédrales du Royaume-Uni. Des moments extraordinaires. Je précise que je dois beaucoup à mon agent, Nathalie Dubourdieu(Ds talents).
Des shows musicaux, du théâtre public, mais aussi un rôle dans Plus belle la vie… Peut-on vous qualifier de touche-à-tout ?
Je trouve qu’en France, il y a trop de fragmentation. On est trop sectaire. Chacun reste dans sa catégorie et les uns observent les autres d’un mauvais œil. Regardez les Américains : leur formation est complète. Un acteur à succès est capable de triompher dans une comédie musicale, avant de jouer une pièce dramatique. Je ne crois pas que mon parcours soit si atypique que ça. Et je refuse d’être catégorisé. Je suis aussi à l’aise à tourner un épisode de série qu’à jouer Fassbinder ou Hercule pour faire rêver les enfants. Tous ces rôles me font me sentir vivant. Je suis un passionné !
Mais surtout, ces multiples expériences m’ont énormément appris. Plus belle la vie, en termes de technicité, d'efficacité du jeu, c’est une vraie école. Trois caméras, 25 figurants, trois prises maximums et un épisode par jour, cela forme à l’efficacité. Ce rythme m’a appris à être autonome, rigoureux. C’est pareil pour Frozen à Disney. J’ai découvert une nouvelle technique, à l’américaine. Là aussi, c’était intense : six shows par jour, quatre jours par semaine. Je me rends compte aujourd’hui qu’à chaque nouvelle expérience, je me suis enrichi. Ce ne sont pas que des contrats, des cachets ou des rencontres humaines, c’est aussi de la rigueur, du travail et un niveau d’exigence à atteindre. Chaque aventure m’a permis de m’améliorer.
 Et désormais vous voilà à l’affiche de Je vais t’aimer. Présentez-nous ce spectacle...
Et désormais vous voilà à l’affiche de Je vais t’aimer. Présentez-nous ce spectacle...
C’est l’histoire d’une bande de six amis, dont un couple, que l’on va suivre de 1964 à 2004, entre Paris, New York et Alger. C’est en quelque sorte quarante ans d’histoire de la France, à travers ces six vies, avec les joies, les drames, les accidents, les amours, les coups de chance et de malchance. On va suivre ces destins, de 18 à 60 ans, vieillir avec eux, y compris physiquement, en termes de posture, de voix ou d’énergie. Tout cela, avec les chansons de Michel Sardou.
Évidemment, nous reprendrons ses grands succès, « La Maladie d’amour », « Je vais t’aimer », « Les Lacs du Connemara », mais aussi de vraies petites perles. En réalité, beaucoup des chansons de Sardou se prêtent totalement à la comédie musicale. C’est même incroyable. Elles sont amenées brillamment par Serge Denoncourt (le metteur en scène, N.D.L.R.). Tout au long du spectacle, le jeu des comédiens va s’entremêler avec les chansons. Une vraie pièce théâtrale et musicale. « Le Privilège », « Parlons de toi, de moi » : tout semblera évident ; cela va en surprendre plus d’un. « Le France » ou le tableau « Les Vieux Mariés » seront sublimes. J’ajoute qu’en suivant ces destins sur quatre décennies, il n’y aura pas que de la légèreté. Il faut s’attendre à des moments forts et poignants. Les drames font aussi partie de la vie. Comme le rappelle Serge Denoncourt, le public vient aussi pour ressentir des émotions.
 Savez-vous pourquoi vous avez été choisi ?
Savez-vous pourquoi vous avez été choisi ?
D’abord, le répertoire de Sardou et ma voix collent parfaitement. Je suis baryton martin, baryton ténor. Mais surtout, quand je vois Thomas, mon personnage, je me reconnais un peu… Il est excessif, énergique, avec un côté révolutionnaire, ou revendicatif. J’ai cette même énergie. Je suis très heureux de défendre ce rôle, et très fier de créer mon premier vrai rôle à la scène. Quel cadeau !
Pour l’anecdote, mon audition en septembre 2020 avait pourtant été laborieuse. Le metteur en scène, Serge Denoncourt m’avait remarqué dans Saturday Night Fever et Bruno Berberes m’a demandé de me présenter avec une chanson qui « envoie ». J’ai choisi « J’accuse ». Une chanson énergivore, rapide, qui réclame une vraie endurance vocale. « J’accuse » est un cri de révolte avec des flèches dans tous les sens. Moi qui suis dyslexique, j’ai eu un mal fou ! Lors du casting, mort de trac, j’ai dû prendre mon papier sur lequel j’avais dessiné les paroles sous forme de rébus. Désormais je la maitrise parfaitement !
Que répondez-vous à ceux qui évoquent une sorte de medley Sardou, sans création musicale…
Qu’ils se trompent ! Il y a une énorme création musicale faite autour de ses chansons. Dans le respect de l’œuvre originale évidemment. Mais avec une adaptation colossale, et surtout une mise en situation, une mise en contexte. Il ne s’agit pas de chanter pour chanter, mais parce que la situation le demande, parce que c’est la seule chose que les personnages peuvent faire à ce moment-là. Ils sont dans un tel état émotionnel, de détresse, de joie, de peine, de doute, qu’ils n’ont pas d’autre choix. C’est tout l’inverse d’un concert. Dans Je vais t’aimer, les chansons ne sont pas du divertissement, elles racontent l’histoire, font avancer la dramaturgie, amènent les émotions. En début et en fin de chanson, les personnages ne sont plus les mêmes. Il s’est passé quelque chose. Tous ces tubes mythiques vont être incarnés, en solo, en duo ou en chœur.
 Parlez-nous de la troupe, de l’équipe…
Parlez-nous de la troupe, de l’équipe…
Je connaissais Sofia Mountassir (Love Circus, Priscilla, folle du désert, Bodyguard…). J’ai rencontré tous les autres, Emji, Hakob Ghasabian, Tony Bredelet, Boris Barbé… Ce sont des personnalités fortes, avec des parcours et des origines multiples. Cela nous rend très complémentaires. En plus de s’échanger des conseils, on se tire tous vers le haut. Il y a une sorte de pression saine qui nous pousse. Car vocalement, c’est du haut niveau : Boris avec sa voix d’ange, Tony avec sa voix rauque. Avec lui, croyez-moi, on sort des clichés, mais je ne peux pas vous révéler pourquoi, vous verrez! Moi-même, leur talent me booste, cela renvoie à sa propre humilité. Quant à l’équipe créative, Serge Denoncourt signe le livret et la mise en scène. D’Eros Ramazotti au Cirque du Soleil, il a fait le tour du monde. C’est un privilège de le côtoyer. Wynn Holmes dirige les chorégraphies. Elle est assistée de Nicolas Archambault, qui était la star de Saturday. Tous deux ont été sur scène par le passé et savent nous guider.
Justement, qu’apporte l’équipe canadienne ?
Nous sommes sur une histoire et un répertoire foncièrement français, et sur un dispositif créatif anglo-saxon, à la Broadway. Je dirais que l’on a pris le meilleur des deux mondes. Je suis frappé notamment par les exigences demandées, la rigueur, l’organisation. Sans compter le temps de préparation, autant en amont. Nous avons ainsi eu deux workshops, d’une semaine, dès le printemps dernier, pour travailler le texte, étudier les personnages, approfondir l’interprétation. Cela a aussi permis d’arriver aux répétitions avec déjà un fort esprit de troupe. C’est extrêmement important.
Et puis, la technicité à l’américaine c’est aussi un fonctionnement par strate. Notamment lors des répétitions. D’abord la mise en place, avant d’ajouter les déplacements, les entrées, les sorties, les accessoires. Puis ont été intégrées les chorégraphies, et le texte à plat, avant de rentrer précisément dans le détail des scènes, d’ajouter costumes, décors, lumières. Tout est fluide… Je ne pensais pas être traversé par tant d’émotion avec du Sardou. Je suis très fier de participer à cette aventure. Je suis sûr qu’elle va toucher trois ou quatre générations.
Pour conclure, avez-vous un modèle ? Quelqu’un qui vous inspire ?
David Ban, David Alexis, Prisca Demarez... Ce sont des joyaux de la comédie musicale française. Et Alexandre Faitrouni qui était mon prof de jeu au cours Florent ; non seulement c’est un comédien d’exception, mais en plus il sait transmettre. Ce mec est un génie (rires).