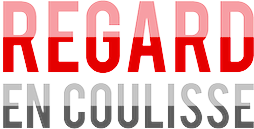De Paris à Rome dans les années 70, le destin d’un écrivain fauché percute celui d’une star montante du cinéma. Leur chemin vers l’amour sera semé d’embuches, de quiproquos et rebondissements. Une comédie musicale et tourbillonnante !
Notre avis. Attention : spoilers ! : Réjouissons-nous des comédies musicales qui arrivent au cinéma. Emilia Pérez a dépassé le million d’entrées, est en course pour les Oscars. Joker 2, L’amour ouf rendent également hommage au genre et aujourd’hui voici que sort le nouveau film de Diastème, avant celui de Stéphane Ly-Cuong, programmé début mars. Alors, que vaut cet opus conçu par le réalisateur (qui a un passé de musicien) en collaboration avec Alex Beaupain et qui offre à la chanteuse à succès Clara Luciani son premier rôle au cinéma ? Le film est une curiosité, indéniablement, que d’aucuns pourront savourer comme un bonbon sucré, vintage et coloré, contenant tout de même un rien trop de glucose. Et c’est tant mieux. Nous serons plus mordants…
« Nul » et « Joli joli » sont deux des premières chansons que l’on entend dans cette comédie musicale. Vers lequel de ces deux adjectifs le film tend-il ? Hélas plutôt vers le premier. C’est dommage car l’ouverture du film a de quoi séduire. Mais très vite, dès le chant des éboueurs (que l’on peut rapprocher de la chanson des femmes et hommes de ménage dans Jeanne et le Garçon formidable, autrement plus inspirée), la mécanique commence à s’enrayer puisque le scénario se perd dans des digressions et va connaître des trous d’air qui pénalisent une intrigue qui semble condenser tous les artifices du mauvais film parisien sur des amours diversement contrariées. Le scénario d’Emilia Pérez, digne d’une télénovela, n’était déjà pas l’élément saillant du film. Dans le cas présent, tout semble sorti d’un roman-photo à l’eau de rose, le côté vintage en sus. L’intrigue se déroule sur une année et débute avec le premier jour de 1977, et narre ces histoires d’amour entremêlées auxquelles on ne croit pas une seconde. Il lui manque un point de vue fort. Les auteurs se contentent d’illustrer une partition bien pauvre, avec des coups de théâtre dignes d’un vaudeville éculé. La convention induite par le genre musical permet d’admettre bien des invraisemblances, mais ici rien ne fonctionne.
Faute à des personnages mous, entre un auteur geignard (pour se suicider, il se défenestre mais… il habite au rez-de-chaussée, ce qui dénote d’un sens de l’humour affirmé), une star de cinéma qui cache son statut (l’auteur, qu’elle rencontre, hiberne et ne va jamais au cinéma, il est bien le seul à ignorer qui elle est), Myrette, la femme de ménage de l’auteur (incarnée par Lara Felpin), qui se meurt d’amour pour lui (ça tombe bien : il n’a pas un sou, et finit par la renvoyer après le passage, le 1er janvier, des huissiers qui saisissent ses biens, sauf son bureau et sa machine à écrire)... Ouf, cette dernière va lui permettre d’écrire le scénario de Joli joli, commande d’un producteur (qui déboule après les huissiers, le 1er janvier étant décidément une journée où il s’en passe !) que l’auteur, méprisant, finit par accepter car il comprend que l’inconnue rencontrée dans le bar en tiendra le premier rôle. Cela facilitera leur future rencontre car la belle, surprise par Myrette, est partie comme une voleuse, à poil sous son manteau* (car elle était trop… bah, elle était trop, quoi, pour enfiler sa robe), ayant pris soin de donner son numéro à Myrette, cette dernière le gardant par-devers elle afin de l’utiliser à son profit. Elle devient en effet l’assistante de la star et va court-circuiter toute tentative de l’auteur pour joindre l’actrice. Futée. Cette jalousie maladive sert donc de carburant à l’intrigue.
Sans doute trop occupé à se défenestrer, l’auteur ne pense pas qu’il peut éventuellement écrire à la vedette, envoyer un télégramme, enfin bref trouver un moyen de la joindre directement. Acceptons la convention, tout comme celle, qui provoqua quelques ricanements parmi l’assistance, qui voit ce pauvre producteur victime, sur un plateau de cinéma cheap censé évoquer Cinecittà, d’une crise cardiaque. Toute l’équipe autour de lui, bien trop occupée à chanter une chanson, ne prend conscience de la gravité de la situation que bien tardivement, alors qu’il convulse depuis un petit moment. Par la suite, il se refera la cerise grâce à une infirmière qui adore la morphine. Le dénouement se déroule dans un cinéma, ou plus exactement dans les toilettes dudit cinéma, lors de l’avant-première de Joli joli, à laquelle aucun journaliste ne vient car Myrette, devenue entre-temps attachée de presse, a oublié d’indiquer le cinéma. Acte manqué. Le hall est celui du feu cinéma Bretagne – cette évocation d’un établissement disparu est bien la seule chose émouvante durant ces séquences. Enfin nous ne dévoilerons pas la fin : Myrette, que l’auteur considère désormais comme son véritable amour (il ne serait pas un peu niais, tout de même ?), va-t-elle se contenter de ce succédané ou succomber au bel ingénieur du son (Victor Belmondo), qu’elle a méchamment allumé ? Les deux figurantes aspirantes vedettes vont-elles enfin se rendre compte que le réalisateur qu’elles ont dragué comme des dingues est homo et que son cœur appartient à son comédien fétiche (quoique l’ingénieur du son…) ? Finiront-elles par découvrir leur véritable nature et, surtout, l’auteur et la vedette parviendront-ils à cet amour impossiblement possible qu’ils appellent de leurs vœux ? Suspense.
Le réalisateur, et c’est une idée qui se défend, prend le pari du carton-pâte, ce qui offre une distance intéressante. La neige s’invite un peu partout, y compris dans une salle de cinéma. Il parle d’émancipation (mais avec une lourdeur…), de progrès technologique puisque l’un des personnages s’agace d’avoir à utiliser une cabine téléphonique, alors qu’il « serait plus simple d’avoir un téléphone dans sa poche », dit-il en riant, certain que cela n’arrivera jamais. Visuellement, notons la laideur des perruques qui affublent la plupart des actrices et acteurs. Bon. Nous n’échappons pas aux clins d’œil pour happy few : Christophe Honoré et Alex Beaupain accoudés au comptoir du bar, Jean-Pierre Lavoignat, ancien patron de Diastème, achète un billet pour voir Providence d’Alain Resnais. En résumé, un film qui court désespérément après la grâce, mais jamais ne l’atteint et encore moins ne la dépasse.
* Sans doute un hommage au personnage campé par Dominique Sanda dans Une chambre en ville, qui se déplace nue sous son manteau de fourrure. Les hommages écrasants abondent dans ce film, des Parapluies de Cherbourg à One from the Heart en passant par Les Demoiselles de Rochefort...