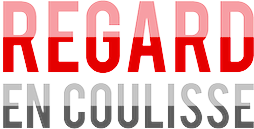On ne peut pas mentionner le nom de Louis Armstrong sans aussitôt évoquer l’une des figures les plus légendaires du jazz classique. Au cours d'une carrière qui s’étala sur plus de cinquante ans, Armstrong, dont le style unique à la trompette autant que la voix rauque et puissante étaient tellement reconnaissables, s’est taillé une réputation mondiale. Cette réputation allait d’ailleurs d’autant plus s'accroître qu’elle s'auréolait de chansons qui devaient devenir d’énormes succès populaires, comme « Black and Blue », « Basin Street Blues », « St. James Infirmary », « You Rascal You », « Tiger Rag « , « Kiss of Fire », « When You’re Smiling », When the Saints Go Marching In », « Avalon » et, bien sûr, « Hello, Dolly! » et « What a Wonderful World » – toutes entendues dans cette œuvre théâtrale, la dernière citée lui ayant inspiré son titre.

Parce que le style de Louis Armstrong était tellement caractéristique et inimitable, on serait en droit d’avoir des doutes sur le choix de l’acteur censé l’incarner sur scène ou à l’écran. James Monroe Iglehart, déjà acclamé pour sa création du Génie dans Aladdin, la comédie musicale de Walt Disney toujours à l’affiche, et celle du roi Arthur dans la récente reprise de Spamalot de Monty Python, est tout simplement extraordinaire de réalisme. Il parle comme lui, avec les mêmes intonations, joue de la trompette comme lui, et manifeste le même sens de l’humour qui lui était propre. Il est rare de trouver un artiste qui soit aussi complet dans son interprétation, mais c’est pourtant le cas ici.

La pièce elle-même suit fidèlement le parcours d’Armstrong : ses débuts vers la fin des années 1910 à La Nouvelle-Orléans, où il était né en 1901 ; son association, à Chicago dans les années 1920, avec la Creole Jazz Band dirigée par King Oliver, qui était devenu son mentor avant qu’il ne forme son propre groupe ; sa carrière à Hollywood dans les années 1930, période pendant laquelle on peut le voir nombre de fois sur les écrans, souvent sous son propre nom ; et ses dernières années à New York, où il s’établit dès 1950 et où il demeura pour le restant de sa vie

Cette existence fut récompensée par de nombreux succès en tant qu’artiste reconnu mais également marquée par quatre mariages – avec Daisy Parker, une prostituée rencontrée lors d’un concert à Gretna, en Louisiane ; Lil Hardin, la pianiste de King Oliver ; Alpha Smith, rencontrée lors d’une tournée dans les années 1920 ; et Lucille Wilson, une chanteuse du Cotton Club à New York, qu’il épousa en 1942 et avec qui il resta jusqu’à sa disparition en 1971. Les quatre actrices chargées d’incarner ces femmes, respectivement Dionne Figgins, Jennie Harney-Fleming, Kim Exum et Darlesia Cearcy, sont toutes excellentes, même si leur interprétation vocale trahit une façon de chanter et d’harmoniser contemporaine, peu en rapport avec le style des chanteuses de jazz les plus célèbres de l’époque comme Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Sarah Vaughan – un anachronisme qui surprend.

Le reste de la distribution, dans les rôles secondaires – Trista Dollison, Dewitt Fleming Jr., Jason Forbach, Gavin Gregory, James T. Lane et Jimmy Magula –, est également à la hauteur. Mais ce qui frappe surtout, c’est la troupe d'une douzaine de chanteurs et danseurs, notamment dans des numéros de claquettes réglés par Dewitt Fleming Jr., qui agrémentent le spectacle chorégraphié par Rickey Tripp et mis en scène par Christopher Renshaw, assisté par James Monroe Iglehart et Christina Sajous.
Sur le plan purement technique, il faut encore signaler les décors monochromes d’Adam Koch et Steven Royal, souvent mis en lumières par Cory Pattack, et les costumes de Toni-Leslie James, notamment ceux réservés aux danseurs. Mais ce que l'on retient avant tout, c’est la qualité de l’ensemble orchestral dirigé par Daryl Waters, avec les nombreuses orchestrations et arrangements musicaux de jazz fournis par l’un des maîtres du genre, Branford Marsalis, dont la réputation n’est certes plus à faire.

A Wonderful World est une œuvre qui ramène les spectateurs à une époque où la musique, et notamment le jazz, avait une importance significative et où les comédies musicales avaient un sens. Son succès va certainement dépendre de l’attrait qu’elle peut exercer sur un large public toujours soucieux de la qualité d’un spectacle de Broadway. Mais elIe devrait permettre à des spectateurs plus jeunes de découvrir et d’apprécier la qualité de certains spectacles vers lesquels ils sont moins naturellement portés, faute de connaissances dans le domaine du jazz. L’enjeu en vaut la peine. Le spectacle aussi !