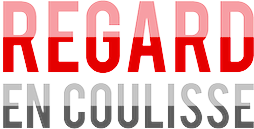Comédie musicale de tous les records, Les Misérables doit son succès à l’universalité de son histoire, qui a su toucher plus de 130 millions de spectateurs à travers le monde.
Notre avis (avant-première du 20 novembre 2024) : Depuis combien de temps n'avions-nous pas été aussi ému par un spectacle, depuis quand n'avions-nous pas eu le souffle à ce point coupé ? Et notre avis pourrait s'arrêter là, tant essayer de comprendre ce que nous avons vécu face à cette nouvelle production des Misérables paraît vain en comparaison du choc qui nous a saisi. Bien sûr, à l'origine de cette émotion, il y a le roman humaniste de Hugo, il y la force de l'adaptation pour la scène qu'en ont faite Alain Boublil, Claude-Michel Schönberg et tous les autres créateurs qui ont façonné cette pièce musicale depuis des décennies, mais pas seulement.

La recréation, dans sa langue d'origine, de cette œuvre majeure du répertoire mondial du théâtre musical, qui a fait le tour de la planète après avoir été créée en France mais sans y connaître le succès qui s'est pourtant imposé partout ailleurs, était annoncée comme l'événement de la saison. Toutes ces années d'efforts par l'équipe de production de Stéphane Letellier pour convaincre un système bien huilé qui tourne depuis presque quarante ans de revenir à Paris n'auront pas été vaines. Le pari est réussi sans équivoque : pas seulement parce qu'il ne reste quasiment plus aucun billet à vendre au Châtelet jusqu'à la dernière le 2 janvier 2025 – il paraît qu'on en trouve encore ou qu'un stock est remis en vente de temps à autre –, mais surtout parce que la qualité artistique de cette nouvelle version atteint des hauteurs vertigineuses.

Pour arriver à un tel niveau de qualité, on imagine sans peine le travail de toute une équipe, la persévérance, à commencer par celle des créateurs. Si Claude-Michel Schönberg explique qu'il a adapté l'orchestration pour le nouvel effectif du Châtelet et s'est concentré sur l'accompagnement vocal, Alain Boublil confie qu'il a remis sur son métier texte et paroles avec l'intention de le rendre encore plus vibrant pour nos oreilles d'aujourd'hui, sans que cela passe par une modernisation du langage à tout prix – la réécriture, toujours ce maître-mot, comme ils l'expliquent tous deux dans le livre d'entretiens recueillis par Remy Batteault.
Si les connaisseurs auront à cœur de comparer les différentes versions pour découvrir ce qui a été modifié, nous ne pouvons que louer un texte fluide et actuel, qui conserve aussi une poésie indissociable de l'esprit du XIXe siècle. Il s'offre d'autant mieux au public qu'il est servi par une articulation exemplaire – une qualité partagée par toutes et tous sur scène – et un naturel qui, comme le compositeur le souhaite, permet au public d'oublier que les artistes sont en train de chanter.

Tout comme le texte trouve un juste équilibre entre authenticité et contemporanéité, la mise en scène de Ladislas Chollat sait raconter sans insister. Peut-être parce que son travail a été pensé à destination d'un public culturellement plus proche du roman, la scénographie fait preuve d'une finesse bienvenue, un peu comme du sur-mesure – au bémol près, le seul que nous émettons ici, que le large plateau du Châtelet semble parfois un peu dépeuplé, notamment lorsque point « Le Grand Jour ».
Une double structure mouvante de grandes dimensions permet de prendre position dans l'usine de M. Madeleine, sur la barricade ou sur les bords de Seine... D'autres éléments mobiles se rajoutent pour la taverne des Thénardier ou le café Musain. Et d'autres, plus petits, permettent de s'inviter chez l'évêque de Digne ou dans l'hôpital ou mourra Fantine. Un tulle, souvent sollicité, permet de délimiter l'avant-scène où les airs solos se déploient tandis que derrière, le tableau suivant se met en place. De cette organisation, simple en apparence mais que l'on suppose techniquement complexe depuis les coulisses, naît une grande fluidité dans les transitions entre les tableaux.

En dehors de plusieurs moments conçus comme des pastels ou des peintures classiques, les nuances de gris-bleu plongent densément le décor dans une ambiance où pénètrent ombres et lumières, à l'instar du combat que se livrent bien et mal dans un contexte où les miséreux cherchent à survivre, en quête d'une liberté qui leur est officiellement interdite.
De magnifiques projections, techniquement réussies, viennent nuancer, habiller sans surcharger, illustrer sans surligner, liquides comme des aquarelles qui apparaissent avant de se dissoudre, comme des impressions photographiques qui se développent puis se fondent. Elles viennent sublimer quelques moments clefs : les spectres qui hantent les tables vides du café Musain, les étoiles auxquelles jure Javert, la pluie de cendres qui recouvre l'attente sur la barricade...

Les costumes de Jean-Daniel Vuillermoz, à la fois réalistes – parce que rapiécés, usés et patinés par la sueur et la crasse, à l'image des misérables qui les portent – et spectaculaires – parce qu'ils éveillent le regard –, soulignent les silhouettes, caractérisent les personnages et apportent leurs couleurs avec une grande sensibilité. Au seul mariage de Cosette et Marius, unique et éphémère instant de bonheur, sera permise une franche touche de noir et blanc, élégante, presque surréaliste, comme en dehors du temps – d'ailleurs, d'autres fantaisies se glissent dans cette scène...

Outre le projet de cette nouvelle mise en scène, le choix de la distribution faisait partie de l'effervescence de l'événement et a naturellement suscité beaucoup d'attention et d'attente. À l'image de la conception scénique, elle s'impose comme une évidence.
Que ce soit dans les ensembles où ils s'unissent pour exprimer l'énergie du groupe ou les détails de leur individualité, ou dans les petits rôles très justement caractérisés, tous les membres de la troupe n'appellent que des éloges. De cet ensemble composé de visages déjà connus, de voix nouvelles, de vétérans – on vous a reconnue, Ariane Pirie ! – se dégage une cohésion, une force tangible qui structure et porte inévitablement le spectacle. Nouvelle preuve, s'il était besoin, qu'il existe autour de nous un vivier de talents.
Les enfants aussi se montrent impeccables : de poésie et de fragilité pour Cosette, flanquée d'un balai démesuré à Montfermeil ; et de malice et d'impertinence pour Gavroche, si attachant – le coup de feu qui le tue nous a durablement secoué.

Maxime de Toledo déploie toute sa noblesse d'âme dans le court rôle de l'Évêque de Digne. Stanley Kassa n'a pas de difficulté à faire de son Enjolras un jusqu'au-boutiste enflammé, investi dans un combat politique et une lutte armée qui l'honorent.

Christine Bonnard et David Alexis trouvent dans l'odieux couple Thénardier des rôles à la mesure de leur savoir-faire, en suscitant à la fois dégoût et cocasserie, sans verser dans le cabotinage : elle avec sa gouaille et son impayable dégaine ; lui, agile filou en diable, absolument répugnant dans ses « Fureurs cannibales » lorsqu'il dépouille les cadavres de leurs objets de valeur, jusqu'à l'or de leurs dents.

Dans un rôle qui n'est pas le plus développé de l'œuvre, Juliette Artigala apporte à sa Cosette juvénilité et ce qu'il faut de rébellion adolescente envers un père protecteur. Le Marius de Jacques Preiss réussit à être moins uniforme que le jeune aristocrate amoureux auquel on pense souvent. En plus de cette facette qu'il donne à voir admirablement, il se montre manifestement concerné par l'enjeu politique de ses pairs et se hisse sur la barricade presque à l'égal d'Enjolras, par son jeu d'acteur soutenu et par une riche vocalité sur toute la tessiture qui affirment sa présence à chacune de ses interventions – et qu'est-ce qu'on a envie de le secouer, de le gifler, lorsque, si méprisant, il laisse partir Valjean, qui vient de lui confesser son passé de bagnard et préfère ne pas être un déshonneur pour Cosette !

On manque de superlatifs pour l'Éponine d'Océane Demontis : ardente, magnétique, vocalement somptueuse, à vous faire fondre par chaque regard qu'elle lance à Marius, à vous transir de tristesse lorsqu'elle livre « Mon histoire ».

La Fantine de Claire Pérot a le timbre tranchant, à vif, de sa déshérence. Encore plus que dans son air « J'avais rêvé », aux accents si poignants, c'est dans sa déchéance et dans la scène des prostituées, où sa rage de explose, puis dans sa mort, qu'elle trouve un ton unique, si personnel, si déchirant, qui rappelle cette fracture qui touchait tant les auteurs chez la créatrice du rôle, Rose Laurens.

La physionomie commune – crâne rasé et barbe fournie – chez Benoît Rameau et Sébastien Duchange confère à Valjean et Javert un faux air de gémellité qui, pense-t-on, va dans le sens des auteurs : bien et mal ne sont l'apanage ni de l'un ni de l'autre ; chacun en a une part et les deux se ressemblent plus qu'il n'y paraît. Notons au passage que la religion, centrale chez Hugo, reste présente dans le spectacle sans être oppressante : si c'est effectivement toujours un évêque qui pousse Valjean sur le chemin de sa rédemption, le dieu auquel ce dernier s'adresse, y compris dans un décor de cathédrale au seuil de sa mort, se ressent plutôt comme une entité supérieure, et les religieuses qu'on nous donne à voir sont avant tout des infirmières emplies de bonté et d'empathie.
Le timbre plutôt clair de Benoît Rameau, sa facilité à passer en voix mixte et en falsetto, font de son Valjean un homme jeune, peu préparé à assumer la charge de père. Son chant sait se faire plus vaillant pour imposer la présence indéniable de son personnage, à la fois résolu dans ses choix et débordant de bonté, jusque dans l'ultime sacrifice. Son grand air « Comme un homme » et, évidemment, sa mort restent des sommets d'émotion.
Chez Sébastien Duchange, le côté sombre, torturé, domine. Son Javert s'impose, là aussi, comme une évidence, par son autorité perverse mais aussi dans les tiraillements qui le tourmentent entre sa perception de la justice et ce que lui renvoie Valjean, son alter ego.

L'orchestre, placé en hauteur derrière la scène, une quinzaine d'instrumentistes sous la baguette pleine d'élan et de finesse de la maestra Alexandra Cravero, insuffle tellement de couleurs différentes et de détails, porte et enveloppe tellement les voix, que c'est un émerveillement de chaque instant.
Dans la salle, le public, à l'image du spectacle qui le saisit, montre sa générosité et exprime son adhésion, dans une attention palpable d'émotion, dans de fervents applaudissements à chaque numéro et, au moment des saluts, dans des remerciements à l'unisson. Quand autant de personnes, de tous âges, notamment des enfants qui n'ont pas pu voir de précédentes versions et qui sont restés assis trois heures durant, sont à ce point bouleversées, comment ne pas penser que Les Misérables, cette œuvre dont on pouvait penser que le tour en avait été fait, trouve ici un frisson d'âme supplémentaire, une renaissance, un autre souffle, une nouvelle plénitude qui devrait indubitablement séduire les curieux et satisfaire les aficionados des Mis !