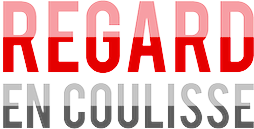Dans une volonté d’élever le genre de la comédie musicale, Jerome Robbins, Arthur Laurents, Leonard Bernstein et Stephen Sondheim s’unissent dans les années 50 pour créer West Side Story. Grandes pointures dans leur domaine – pas encore tout à fait pour Sondheim qui n'est qu'au tout début de sa carrière –, ils côtoient les hautes sphères des arts dits légitimes comme le ballet, l’opéra, le théâtre et la musique symphonique. Ils souhaitent alors extraire le meilleur de leurs compétences respectives dans ces arts pour créer une nouvelle forme scénique. Jerome Robbins expliquait « Pourquoi aurions-nous dû faire les choses séparément et ailleurs ? Pourquoi Lenny aurait-il dû écrire un opéra, Arthur une pièce de théâtre, moi un ballet ? Pourquoi ne pourrions-nous pas aspirer à essayer de réunir nos talents les plus profonds dans cette œuvre à destination de l'industrie du théâtre ? C'était ça, le véritable geste du spectacle. »1
En plus de révolutionner la forme de la comédie musicale, ils s’attachent aussi au contenu, et font de West Side Story un spectacle adulte qui aborde frontalement des sujets profonds, politiques. Ils n’hésitent pas à mettre en scène de la violence : haine raciale, viol, meurtre... ce qui était peu courant dans les spectacles de l’époque.

GENÈSE DU PROJET : L'IDÉE ET L'ÉQUIPE
En 1949, c’est Jerome Robbins qui approche Leonard Bernstein et Arthur Laurents pour leur soumettre l’idée d’une adaptation du Roméo et Juliette de Shakespeare en une œuvre musicale contemporaine. Pour ce projet, ils puisent donc dans une source « savante », un monument du répertoire classique tandis que les livrets des musicals à Broadway s'inspirent généralement d'histoires moins classiques.
À ce stade de la création, le spectacle ne s’appelle pas encore West Side Story, mais East Side Story, et les auteurs réfléchissent alors à représenter la tension entre les communautés juive et chrétienne du quartier Est de New York à travers l’histoire d’amour d’un couple issu des deux groupes antagonistes. Au fur et à mesure qu’ils travaillent sur le projet, le contexte socio-économique évolue et ce n’est qu’en 1955 que l’idée centrale apparaît. Leonard Bernstein et Arthur Laurents se retrouvent tous deux à Los Angeles, le premier pour diriger un concert au Hollywood Bowl et le second pour travailler sur un film. Au bord de la piscine, Bernstein remarque la Une d’un quotidien rapportant les émeutes entre gangs anglo-saxons et mexicains dans les rues de Los Angeles. Après quelques échanges, le déclic a lieu : leur comédie musicale opposera deux bandes de jeunes ; et au lieu de familles juives et catholiques, les personnages deviennent de récents immigrants portoricains face aux enfants d’immigrés blancs d'origines polonaise et irlandaise, plus ancrés mais tout aussi pauvres. Ils se disputent un petit morceau de territoire, une rue dans ce ghetto urbain densément peuplé. C’est ainsi que se construit cette équivalence moderne aux rivalités entre Montaigu et Capulet.
CONTEXTE
Que les auteurs aient fait le choix de s’orienter vers les rixes entre gangs de jeunes n’est cependant pas un hasard. En effet, ces conflits constituent l'un des terrains fertiles de l'anxiété après la guerre aux États-Unis. L’inquiétude de la classe moyenne concernant la montée de la délinquance juvénile, en particulier au sein des populations noires et de la classe ouvrière, est prégnante et accentuée par la couverture médiatique. Ce phénomène persiste tout au long des année 50, même dans les zones où la violence et la criminalité liées aux jeunes sont en baisse constante depuis la fin de la guerre. Cette peur généralisée face à des éléments jugés incontrôlables et susceptibles de « contaminer » voire d'« infecter » la culture américaine atteint son apogée au milieu des années 50, au moment même où la crainte du communisme s’accentue et alimente la popularité de McCarthy.
L’obsession envers la délinquance juvénile s’explique aussi par l’avènement des nouveaux contenus dans les médias et la force qu’ils exercent dans la socialisation des jeunes : les bandes dessinées, le cinéma et les nouveaux genres musicaux comme le rock’n’roll. La classe sociale des adolescents se dessine de plus en plus et s’affirme.
Cependant, West Side Story ne participe sans doute pas à nourrir cette frénésie et ne cherche pas à alimenter les peurs potentielles des spectateurs. Au contraire, le spectacle dépeint des êtres complexes qui sont plutôt de tragiques victimes de leur époque et des circonstances. Les personnages que l’on peut facilement détester sont d’ailleurs davantage les adultes (un travailleur social incompétent, un policier menaçant et un officier qui ne se fait pas respecter et qui prend parti). Ils ne constituent en aucun cas des modèles, sauf Doc, le propriétaire du drugstore, QG des Jets, qui se positionne contre les violences des deux gangs.
Pour ce qui est de la composante raciale du spectacle, lorsque la comédie musicale est produite en 1957, l’identité portoricaine a déjà pénétré l’imaginaire américain en raison de l’exode massif depuis l’île vers les États-Unis dans les années 40. Bien que Porto Rico fasse partie des États-Unis depuis la fin du XIXe siècle et que la citoyenneté américaine soit ouverte aux Portoricains en 1917, aux yeux des Américains, les immigrants gardent leur altérité et leur propre identité définie par leurs racines hispaniques, leur langue et leur culture.
ÉCRITURE
Une fois les grandes lignes du récit posées, Sondheim rejoint l’équipe créative pour écrire les paroles. Lui-même compositeur, il est inclus dans le processus de composition musicale et forme un véritable duo avec Bernstein. Sur certains morceaux, il va par exemple suggérer de changer le rythme afin de dédoubler les notes pour rajouter des syllabes et ainsi étoffer les paroles. Cependant, Bernstein, en grand fan de musique cubaine, s’était déjà attelé à l’exercice et avait quelques partitions en stock. Il s’est par exemple inspiré de son ballet Conch Town, qu’il n’avait jamais terminé, pour le numéro "America". Il récupère aussi quelques morceaux originellement composés pour l’opérette Candide qui sont devenus "One Hand, One Heart" ou encore "Gee! Officer Krupke".
Il existe tout de même des désaccords au sein du duo compositeur-parolier. Dans l’écriture des lyrics, la poésie fleur bleue de Bernstein se confronte souvent au sens plus réaliste que Sondheim souhaite accoler à ses textes. Alors que Bernstein avait écrit des premières ébauches de paroles pour certains numéros, Sondheim prend soin de les réécrire pour qu’elles collent davantage à la réalité du personnage, à son environnement. Par exemple, pour Sondheim, l’imaginaire de Tony doit davantage reposer sur l’univers du sport et des matchs de basket que sur la poésie de Bernstein, et il doit insister pour que les mots chantés semblent réellement venir du personnage et non pas de l’auteur. Il ne gagne pas toutes les batailles et, pour lui, les paroles de "Tonight" restent bien trop poétiques.

Arthur Laurents rencontre de son côté le problème du langage qui, à Broadway, est encore très policé. Difficile donc d’y amener le parler fleuri d’une jeunesse délinquante. Il choisit tout de même des mots provocateurs sans verser dans la vulgarité et y ajoute une espèce de sabir imaginaire, qui ne fixe pas l’argot dans une époque. Chez les Jets, Riff s’exclame « frabba jabba » ou Snowboy « riga diga dum » dans la scène 1 de l’acte I. Chez les Sharks, il utilise bien sûr la langue espagnole. Il invente aussi le terme « Beat it » qui sera traduit par « Casse-toi » en français et qui sera repris par Michael Jackson dans sa fameuse chanson homonyme. Sondheim est aussi confronté à la problématique du langage et il est le premier parolier sur Broadway à oser inclure le mot fuck dans une chanson : "Gee! Officer Krupke". Toutefois, l’éditeur musical pense que la vente des disques pourrait en pâtir dans les États conservateurs. C’est Leonard Bernstein qui a le dernier mot et propose de finir la chanson non pas par ce mot jugé obscène, mais par un jeu de mot encore plus incisif : "Krup you!" Ce coup de maître est considéré comme la meilleure parole du spectacle par Sondheim.
Une dernière personne indispensable arrive plus tard dans le processus de création : le chorégraphe Jerome Robbins. Tout comme Sondheim, il participe grandement à donner du réalisme à l'œuvre. Pour concevoir ses ballets, il fait des recherches, regarde des films sur la jeunesse, la rue, visite une école de danse dans le Harlem portoricain et note les mouvements qu’il n’avait jamais vus auparavant. Il observe par exemple une danse où un couple, après avoir débuté à l’unisson, se sépare et ne se touche plus pendant le reste du morceau. Cette danse lui inspire la séquence de rencontre entre Tony et Maria dans "Dance at the Gym". Touchés par le coup de foudre, les deux personnages dansent ensemble sans contact : lentement, synchrones, en s’observant.


RÉPÉTITIONS ET MONTAGE DU PROJET
Pour monter ce chef-d’œuvre, il ne faut pas moins de huit semaines de répétitions, ce qui est deux fois plus que d’habitude à Broadway. Une des raisons pour laquelle le processus est si long est que, dans West Side Story, les chorégraphies sont nombreuses. Jerome Robbins choisit d’incorporer des scènes dansées tout au long de la trame narrative qui deviennent indispensables à la compréhension de l’histoire : la danse fait partie intégrante de la narration et n’est pas reléguée à un unique dream ballet comme dans la majorité des comédies musicales de l’époque.
Le traitement de Jerome Robbins envers ses danseurs pendant les répétitions fut, à posteriori, critiqué. Par exemple, dans les studios, il affiche des coupures de presse à propos des gangs pour donner à la troupe une idée du monde qui entoure leurs personnages et qu’ils doivent reproduire sur scène. Il conditionne les artistes en faisant en sorte qu'ils éprouvent de la haine les uns envers les autres. Ainsi, il empêche les comédiens des deux gangs de manger ensemble, colporte des ragots sur certains, ne les appelle pas par leur prénom mais par celui de leur personnage, et n’hésite pas à les humilier devant leurs collègues. Enfin, il exige beaucoup des danseurs : il demande à chacun de posséder son personnage, de savoir d’où il vient, ce qu’il fait dans la vie, sa famille, etc. Cela peut paraître normal aujourd’hui, mais à l’époque, un ensemble de danseurs était plutôt assimilé à un corps de ballet uniforme et plutôt décoratif.


La troupe doit refléter la diversité des rues, c’est pourquoi Jerome Robbins ne veut pas de star qui puisse être reconnaissable. Il fait passer énormément de castings, se rend même à Porto Rico à la recherche de talents. La plupart de ceux qui sont rappelés sont avant tout des danseurs qui savent chanter. Cela montre bien l’importance centrale du mouvement et de la danse dans l'œuvre. De toute façon, il est évident que les artistes choisis doivent être de véritables triple threats (littéralement triple menace, ce qui veut dire qu’ils maîtrisent les trois disciplines que sont le chant, la danse et le théâtre) pour pouvoir se frotter à cette œuvre monumentale et ses rôles magistraux, comme celui d’Anita par exemple qui est très exigeant dans toutes les disciplines.
LE SPECTACLE
West Side Story est donc un spectacle très complet et complexe en comparaison des spectacles de son époque. La production d’origine ne s’interrompt même pas pour attendre les applaudissements, il n’y a pas de numéro qui meuble les changements de décors, de costumes... Le spectacle est en mouvement perpétuel, presque cinématographique : tout s’enchaîne. Les danses intenses, vibrantes et la partition qui mêle des éléments de musiques classique et populaire sont soigneusement intégrées à l'intrigue pour aider à planter le décor et à en dessiner ses jeunes personnages.
Rentrons plus en détails dans ce que représente West Side Story en analysant quelques-uns de ses numéros les plus connus.
"DANCE AT THE GYM"
Un des numéros les plus marquants est "Dance at the Gym". Organisé par quelques adultes qui pensent, à tort, qu'il apaisera les tensions ; ce "bal" a plutôt l’effet contraire car en plus d’embarrasser les jeunes, il leur permet de planifier la grande bagarre qui aura lieu le soir même. Après une tentative avortée de la part des adultes de les faire danser ensemble sur une musique presque militaire qui rappelle celle des marching bands, les jeunes transforment la rencontre en un concours de danse. Encore une fois, il est question de gagner : gagner l’espace de la piste de danse qu’ils se dérobent à tour de rôle. Alors que les Sharks se lancent les premiers pour danser un mambo, les Jets enchaînent en se moquant d'eux. La musique ralentit ensuite lorsque l'attention est mise sur Tony et Maria, comme si le temps s’arrêtait autour des deux personnages qui tombent amoureux instantanément. Sans même se parler, ils se mettent à danser en gardant leur distance, sans jamais se toucher. Cette danse inspirée par une forme traditionnelle que Jerome Robbins a observée dans le Harlem portoricain (voir plus haut) était sans nul doute un choix audacieux pour illustrer un coup de foudre entre deux personnages. La rencontre entre Tony et Maria prend d'ailleurs moins de dix lignes dans le livret : la primauté et l’importance de la danse dans l’œuvre fait de West Side Story le musical au plus court livret jamais écrit en comédie musicale à l’époque.
UN NUMÉRO CENTRAL : "AMERICA"
"America" est chanté par les Portoricaines et délivre un message patriotique pro-américain via le personnage d’Anita qui, en dépit de ses origines et de sa culture, explique préférer le confort à la façon de l'American way of life. La chorégraphie et les rythmes latinos de ce numéro donnent une idée de l'image de l'exotisme qui était répandue à l’époque. À l’origine il est chanté seulement par les filles latino-américaines, mais dans les versions ultérieures le point de vue anti-intégration est souvent repris par les hommes des Sharks : les femmes voient dans leur pays d'accueil l’aubaine de s’échapper, d’être libres et indépendantes avec un confort de vie amélioré tandis que les hommes dénonce ce rêve d’assimilation parfaite qui équivaut pour eux à l’échec social qu’incarnent les Jets. Les Portoricains s'opposent entre eux et se querellent puisqu'ils sont idéologiquement divisés entre partisans de l'assimilation et nationalistes.
Anita présente Porto Rico comme un pays sous-développé sujet aux maladies, à la criminalité, à la surpopulation et à la pauvreté. Bernardo démystifie ce point de vue, mais ses commentaires sont réduits au silence par les partisanes de la propagande pro-américaine.
L’attitude d’Anita envers l’Amérique évolue au cours du spectacle et change radicalement après la mort de Bernardo ; elle affirme alors sa différence culturelle dans son duo avec Maria "A Boy Like That" à travers des paroles comme « Stick to your own kind » (Reste avec tes semblables). Elle prône désormais la ségrégation ethnique. Et en cela, l’œuvre peut sembler finalement postuler que les Portoricains seront toujours des Portoricains, avant tout, et qu’en cas de problème, ils seront toujours aux côtés de leur peuple et ne seront jamais parfaitement assimilés.
Le numéro "America" est d’ailleurs très mal accueilli par la communauté portoricaine. En effet, tandis que les jeunes femmes vantent les prétendues splendeurs de l’Amérique, elles dénigrent aussi grandement leur île d'origine en comparaison. L’équipe créative reçoit alors des plaintes et se voit demander de changer certaines paroles. À Broadway, rien ne change, mais, sur grand écran le texte évolue.
| SPECTACLE (1957)
Puerto Rico... |
FILM R. WISE (1961)
Puerto Rico… |
FILM S. SPIELBERG (2021)
Puerto Rico, |
FIN : UNE RÉCONCILIATION EST-ELLE POSSIBLE ?
La fin du spectacle sort de l’ordinaire pour le Broadway de l’époque. Avec West Side Story, l’équipe ose une fin tragique. Elle diffère cependant de son œuvre source Roméo et Juliette : après la mort de Tony, Maria ne se suicide pas, elle s’effondre, désabusée, elle est déjà morte par tout ce qui lui est arrivé. L’équipe créative a dessiné une Juliette plus contemporaine, un personnage trop fort pour se tuer par amour : elle s’élève et blâme les deux gangs réunis qui ont tous deux leur part de responsabilité dans les meurtres de Riff, Tony et Bernardo.
Certains voient une lueur d’espoir lorsque les deux gangs se réunissent autour du cadavre de Tony pour le porter à l’unisson en dehors de la scène, mais il est aussi facile de rester sur une note négative lorsque Maria affirme : « I can kill now because I hate now. » Ces paroles montrent combien un personnage même pur peut entrer dans le cercle de la violence : « Je peux tuer désormais car j’ai de la haine maintenant. »
RÉCEPTION CRITIQUE
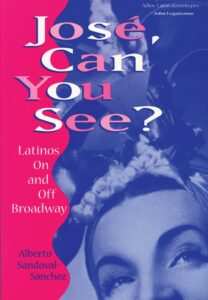 Même si ce musical est, à juste titre, considéré comme un pur chef-d'œuvre, il a suscité diverses réactions critiques. Considérons celles d'Alberto Sandoval-Sánchez, en s'appuyant sur son écrit José, Can You See?: Latinos On and Off Broadway, dans lequel il consacre tout un chapitre à West Side Story.
Même si ce musical est, à juste titre, considéré comme un pur chef-d'œuvre, il a suscité diverses réactions critiques. Considérons celles d'Alberto Sandoval-Sánchez, en s'appuyant sur son écrit José, Can You See?: Latinos On and Off Broadway, dans lequel il consacre tout un chapitre à West Side Story.
Sandoval-Sánchez explique que son projet est né alors que, assistant à une représentation de West Side Story, il venait de voir un public entièrement composé de Blancs applaudir après le numéro « America ». Il explique que cela l’a choqué car, comme nous l’avons vu plus haut, "America” participe à la construction idéologique du stéréotype identitaire des immigrants portoricains et, plus largement, de la communauté latino aux États-Unis. L’auteur affirme que, comme West Side Story est écrit dans le genre de la comédie musicale (avec des chansons, des danses, du mélodrame…), cela peut distraire l'audience qui ne voit plus le racisme dans l’œuvre, mais seulement le divertissement et la célébration de certains traits stéréotypés d’une culture.
Pour l’auteur, ce musical traite davantage d’une confrontation raciale et socio-économique en représentant l’immigration portoricaine comme une menace à l’ordre établi par les Jets, une menace pour leur territoire. L’intrigue commence d’ailleurs avec les Jets repoussant les Sharks de leur territoire, ce qui crée immédiatement une certaine hiérarchie : les Jets étaient là avant et ce sont ceux qui détiennent le pouvoir. De plus, les paroles des Jets récupèrent et véhiculent les stéréotypes raciaux sur les Portoricains répandus à l’époque (violence, pauvreté, disposition à se battre ou à tuer). Dans l’ouverture, ils parlent en premier, ils détiennent la parole et s’en servent pour qualifier péjorativement les Sharks, comparant même leur immigration à une invasion de cafards. Si l’on observe leurs mouvements, les Jets s’étalent, font de grands mouvements, ils sont à l’aise, prennent l’espace, étendent leurs bras et leurs jambes, etc. tandis que les Sharks bougent de manière plus sournoise et très coordonnée, tournent, observent, changent de directions, sont hyperconscients de leur entourage, se font petits, presque sur la défensive. Ces mouvements codés par la chorégraphie sont porteurs de sens que nous comprenons, même inconsciemment.


L'auteur questionne aussi de nombreux autres aspects de la pièce, notamment le nom choisi pour les deux gangs. Sharks (les requins) dénote une bête dangereuse, effrayante qui renforce le potentiel barbare et criminel des Portoricains. Leur apparence physique est aussi le reflet d’une binarité : les Jets sont blonds, forts, dynamiques, vigoureux tandis que les Sharks sont plus fins, bruns et mal coiffés, aux visages sales et huileux. On trouve en introduction du livret une phrase intéressante : "The Sharks are Puerto Ricans, the Jets an anthology of what is called 'American.'" (Les Sharks sont des Portoricains, les Jets une anthologie de ce qu'on appelle « Américain ».)
ADAPTATIONS
Dans les productions ultérieures, les pratiques racistes ont même été perpétuées dans le processus créatif. Par exemple, pour reproduire l’idée stéréotypée du Portoricain, les membres de la troupe jouant les Sharks étaient souvent tenus d’assombrir leur peau et leurs cheveux à l’aide de maquillage. Même l’actrice portoricaine Josie de Guzman était considérée comme pas assez « sombre » pour correspondre à l’image que l’audience se faisait d’une « réelle Portoricaine ». Ici, on détermine leur identité seulement par leur ethnicité et le fait d’être des personnes de couleur. D’un autre côté, on peut aussi s'interroger sur le récent choix en France de Marie Oppert pour interpréter Maria. Rappelons également que Leonard Bernstein lui-même avait choisi Kiri Te Kanawa, une soprano néo-zélandaise à l'anglais distingué, en Maria et un Tony espagnol, José Carreras, pour l'enregistrement discographique résolument lyrique qu'il dirigea en 1984 ; ce "renversement ethnique" avait, en son temps, suscité des commentaires.
Sandoval-Sánchez nous rappelle que West Side Story a été écrit par un groupe d’hommes blancs qui ne pouvaient pas vraiment se rendre compte de ce que c’était d’être portoricain ou latino à leur époque à New York. Certaines femmes latinos expliquent qu’elles ont pu ressentir le "Maria syndrom", se retrouvant tiraillées entre deux faces opposées de leur identité. D’un côté, on présente Maria comme une sainte, une vierge, l’archétype de l’ingénue prête à tout sacrifier par amour et, de l’autre, il y a Anita, femme plus libre, affirmée, colérique, et moins contrôlable. Il va sans dire qu’une palette infinie existe entre ces deux personnages pour représenter la femme latina. Cette œuvre est désormais un classique, très souvent produit, mis en scène dans de nombreux lycées, théâtres... mais reproduisant chaque fois une vision stéréotypée de la communauté portoricaine imaginée par des descendants de la population dominante anglo-américaine.
Lors de la reprise à Broadway en 2009, Arthur Laurents admet que son livret original est daté et effectue de nombreux changements. En 2020, la pièce revient à Broadway dans une mise en scène signée du duo belge composé du metteur en scène Ivo Van Hove et de la chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker. Il opère de nombreux changements et coupe notamment le Dream Ballet de "Somewhere" et la chanson "I Feel Pretty" ; deux numéros qui représentent pourtant une dose d’espoir et d’affirmation pour la communauté portoricaine. Pour le casting, il choisit des artistes de couleur, aussi bien chez les Sharks que chez les Jets, afin de représenter une Amérique contemporaine. Mais cela ne fut pas reçu comme il l’entendait car beaucoup y ont lu un message plus hostile. En effet, en enlevant tous les personnages blancs du spectacle, ce qui en résulte est que la violence est l’apanage des personnes de couleur. En plus de cela, l’aura et la stylistique contemporaine de cette équipe créative n’étaient pas forcément taillées pour le caractère plus commercial du théâtre de Broadway ou tout simplement pour ce que le public attend d’une comédie musicale, même tragique.
Tous ces éléments n’ont pas empêché de faire de West Side Story l’un des plus grands classiques de la comédie musicale. Mais, avec le recul de notre époque, il est intéressant de voir à quel point cette œuvre ne cesse de jouer sur des paradoxes.
Créée à partir de moyens d'expression qui étaient jusqu’alors plutôt associés à la comédie – chant, danse –, l'œuvre qu'en ont fait ses créateurs laisse un goût plus amer, fouille un univers plus adulte au point d'être considérée comme l’une des plus grandes tragédies américaines.
Et justement, l’identité si américaine de cette œuvre ne l’empêche pas de constituer une véritable critique de l’American dream ou de la doctrine du self-made man dans un pays où les inégalités ont été et sont toujours bien présentes.
Enfin, alors qu’elle se veut un plaidoyer contre le racisme, il est aisé de déceler un racisme plus pernicieux, quotidien, qui pouvait encore passer inaperçu à l’époque de sa sortie.
SOURCES / POUR ALLER PLUS LOIN :
1 McCulloch, Lynsey and Brandon Shaw (eds) : The Oxford Handbook of Shakespeare and Dance, Oxford Handbooks (2019; online edn, Oxford Academic, 5 Mar. 2020).
- Alberto Sandoval-Sánchez : A Puerto Rican Reading of the America of West Side Story extrait de José, Can You See? Latinos On and Off Broadway
- Laurent Valière : La Story de West Side Story, France Musique.
- Elizabeth L. Wollman : A Critical Companion to the American Stage Musical, Bloomsbury Publishing.