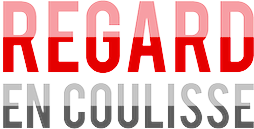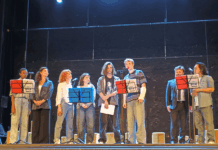Comment vous est venue l’idée de ce projet ? Est-il né d’une fascination pour Sarah Bernhardt ?
Pas du tout ! Cela m’est venu d’une manière très pratique. Quand j’ai commencé à monter des comédies musicales à Paris, des producteurs privés me demandaient toujours – et à mon avis pour de mauvaises raisons – : « Qu’est-ce que vous avez envie de faire vous-même ? ». Comme je mettais en scène des spectacles assez importants, je me suis dit que ce serait bien d’avoir dans mon escarcelle le projet d’un spectacle d’époque, large, lourd, éventuellement cher, avec du monde sur scène, avec des possibilités de décor… J’avais envie d’un « biomusical », sur un thème très français, mais ne laissant pas indifférent les Anglo-Saxons, dans l’éventualité de l’exporter ensuite dans ces pays-là.
À l’époque, j’étais en contact avec Yannick Bellon, une metteuse en scène féministe avec qui j’avais écrit et joué dans deux films. Yannick m’a fait rencontrer l’univers féministe parisien et je suivais les publications des Éditions des Femmes, qui se trouvaient rue de Seine. Un jour, je vois en vitrine les Mémoires de Sarah Bernhardt. J’ignorais totalement l’existence de ces écrits. J’aurais pu le savoir, mais Sarah Bernhardt était persona non grata dans le type d’études théâtrales que j’avais faites. Pour moi qui avais fait le conservatoire comme comédien, l’idée courait que c’était une vieille ringarde.
J’étais d’autant plus intrigué que je ne voyais pas ce qu’il y avait de féministe dans son parcours pour qu’elle soit publiée par ces éditions. Je me suis donc jeté sur ce livre. À l’époque, j’étais en tournée avec les Pédalos [N.D.L.R. : Essayez donc nos pédalos, spectacle écrit, composé et co-interprété par Alain Marcel à la fin des années 70] et je lisais dans le bus toute la journée. J’ai tout de suite été fasciné par l’écriture, qui est magnifique, et par l’extravagance du personnage.
Ce bouquin me paraissait tellement correspondre aux paramètres que je m’étais donnés, que je me suis dit que lorsque des producteurs de comédie musicale m’interrogeraient sur mes créations futures, avec une possible carrière anglo-saxonne, je leur proposerais Sarah Bernhardt, the Musical. Mais à ce moment-là, j’ai compris que ces producteurs me proposaient en réalité de monter ce que eux avaient envie de monter. Ils n’étaient pas du tout dans l’optique d’une écoute du risque pris sur une création. J’ai donc rangé ça dans un coin de ma tête, j’ai pris quelques notes et au bout de vingt ans, j’avais une chemise avec quelques idées.
C’est l’aventure d’Aziz et Mamadou [N.D.L.R. : Le Paris d’Aziz et Mamadou, comédie musicale écrite, composée et mise en scène par Alain Marcel à l’Opéra Bastille en 2004] qui m’a décidé à m’y remettre. Des producteurs s’intéressaient à ce spectacle, mais quand ils voyaient qu’il fallait un minimum de onze à treize personnes, ils me disaient : « Mais vous êtes fous ! On n’est pas à Broadway ! » Ce n’était pourtant qu’un spectacle avec six costumes, cinq musiciens, et une possibilité de plateau totalement dénudé… Comme je voulais absolument faire une création, je me suis dit alors qu’il fallait aller à l’infiniment petit et ce projet Sarah Bernhardt m’a semblé idéal. J’avais commencé à imaginer l’histoire d’un homme qui n’arrivait pas à monter un immense spectacle sur Sarah Bernhardt et qui, du coup, nous le racontait par le truchement d’un tout petit spectacle… Et ça a donc donné cette sauce : un projet de comédie musicale, et plus précisément un « biomusical », qui puisse intéresser les Anglo-Saxons, et qui parle de l’infaisabilité d’un spectacle musical !
Jérôme [N.D.L.R. : Jérôme Pradon, comédien seul en scène de L'Opéra de Sarah] est venu voir Aziz et Mamadou et a souhaité qu’on travaille ensemble, je lui ai proposé ce projet. Au départ, j’avais des formules à un, deux ou trois personnages. De concert, on a choisi la formule à un personnage.
Comment êtes-vous venu à cette forme de narration très inédite ?
C’est venu petit à petit. Je suis parti dans deux directions. J’ai commencé d’un côté à travailler sur des scènes parlées. Je savais dès le départ que j’avais un narrateur masculin qui parlait pour lui-même, mais qui présentait aussi les autres et qui parlait à leur place.
C’est une chose qui était donnée dès le départ et qui remonte à mon travail avec Antoine Vitez au conservatoire. J’avais trouvé profondément novateurs ces travaux qu’on avait faits avec lui sur le fait de transformer en théâtre des objets textuels non théâtraux. On avait travaillé sur des articles de journaux, sur des romans. J’avais acquis à l’époque la conviction que tout texte est théâtral : une fable, un poème, une thèse académique…
Je m’étais dit que je voulais procéder en sens inverse : au lieu de rendre théâtral un texte non théâtral, j’allais écrire un texte non théâtral pour le rendre théâtral moi-même ! Donc, je savais déjà ce que je voulais faire du côté parlé. Et je m’imaginais qu’entre ces scènes parlées allaient se greffer, comme dans un musical traditionnel, de grandes structures chantées, soit dialoguées, soit monologuées, soit en situation, soit en regard sur la situation. Je pensais vraiment à l’époque que ce spectacle serait une alternance de parlé et de chanté. Et comme j’aime beaucoup dans le musical anglo-saxon le système de l’underscoring, à savoir des thèmes qui relient les scènes, je pensais bien que j’allais travailler sur l’underscoring… mais d’une manière beaucoup moins développée et systématique que ce qu’on a effectivement fait.
J’ai commencé à écrire des scènes, des chansons. J’ai écrit « Fleur de lait », « Plaire », « Pour l’amour du théâtre »… qui étaient chacun des morceaux de plus de six minutes de chant pur. Et quand je me suis rendu compte à quel point je racontais peu l’histoire de Sarah Bernhardt, je me suis dit que j’étais très mal ! J’ai réalisé que mon propos était trop long.
Comme j’avais trente scènes prévues, j’ai coupé en deux et je me suis donc dit que j’allais développer deux parties. Mais là, nouveau problème ! Je me rends compte à nouveau que dès que je racontais l’histoire, on était dans des scènes parlées. Dès qu’on chantait, l’histoire n’avançait plus vraiment. Il fallait que je trouve une formule où l’histoire avance tout en ayant notre narrateur qui n’arrête pas de parler, ni de chanter. Il s’est alors imposé qu’il fallait entremêler les choses. C’est sur « Fleur de lait » que l’on a trouvé la solution. Ce qui au départ était une chanson a été démembré, découpé, relié par des saynètes, de la musique, des arrêts de musique… C’est comme ça qu’on a trouvé le principe que j’ai essayé de garder sur toutes les scènes.
Vous avez écrit, composé et mis en scène. Lorsque vous travaillez, suivez-vous une méthodologie précise ou plutôt votre instinct ? À moins que chaque projet ne soit différent dans son approche ?
Chaque projet est différent, mais je suis très structuré à l’intérieur d’un projet. Je fais d’abord un très gros travail de préparation, puis de sédimentation de cette préparation, puis un travail de construction. Si on regarde mon premier plan détaillé, qui contient des notes, des idées de lyrics, de situations de scène, on se rendra compte que ce que j’ai pondu il y a trois ans est extrêmement proche du spectacle. Ensuite, quand j’attaque une nouvelle scène, je fais toujours un déroulé – sur une à deux pages selon la complexité de la scène – où je raconte précisément ce qu’il se passe, comment tout s’enchaîne. Si on lit mes déroulés, on verra aussi que c’est extrêmement proche du résultat final. J’écris toujours trop volontairement, de manière à ce que l’on dégraisse ensuite.
Puis j’apporte le matériel musical à Damien [N.D.L.R. : Damien Roche, pianiste et arrangeur du spectacle] qui s’en empare et lui trouve sa couleur pianistique et, à ce moment-là, on fait une espèce de « montage », dans le sens cinématographique du terme : de l’editing. On met des choses bout à bout et on trouve le rythme et le sens en coupant-collant. On essaie toujours d’y laisser une construction, une structure, une évolution du sens et de la musique. C’est un « soupesage » constant…
Quelles ont été vos influences musicales pour ce spectacle ?
Généralement, je m’amuse toujours à faire des chansons tirant vers la variété, mais là, dès le départ, je savais que je ne pourrais pas m’en sortir en faisant,, par exemple une parodie de tango, de fox-trot ou de rock ! Dans Aziz et Mamadou, il y avait un faux rap, une java… J’aime bien jouer sur les parodies, mais là je savais que ce n’était pas possible. J’ai vu tout de suite qu’il faillait un univers harmonique et musical un peu sophistiqué. Avec Damien, on a donc travaillé sur ces harmonies pour essayer de créer un pont entre l’univers de Scott Joplin, du jazz et du rag, et celui de Ravel, Debussy et Fauré. J’ai aussi utilisé les accords de sixième et neuvième qui sont très peu « variétisants » mais qu’on trouvait régulièrement dans la musique de scène jusque dans les années 20, jusqu’à Kurt Weill par exemple, pour essayer de créer une jonction entre la comédie musicale, le jazz et l’esprit des compositeurs français de la fin du siècle. Ce qui est amusant, c’est que ce n’est pas du tout l’univers musical de Sarah Bernhardt. Elle n’a pas travaillé avec les modernistes comme Ravel ou Debussy, mais plutôt avec les parnassiens, les académiques comme Gounod.
Après, selon les scènes, on s’est aussi amusé avec d’autres univers. Pour la scène de Londres, j’ai fait intervenir le vieux musical anglais. À New York, j’ai ramené les atmosphères rag, par exemple…
Vous avez écrit ce spectacle spécifiquement pour Jérôme Pradon. Quels sont les avantages et les inconvénients d’écrire pour une personne en particulier ?
Il y a surtout des avantages ! Les seuls inconvénients que l’on peut rencontrer sont les limites des personnes pour qui on écrit. En matière de comédie musicale parlée chantée, quand on écrit pour un excellent chanteur qui est un acteur moyen, on sait qu’on ne peut pas se permettre certaines choses. Et vice versa !
Avec Jérôme, ce qui est très agréable, c’est qu’il n’y a pas de limite sur le plan musical. Il n’y a aucune complexité qui puisse lui faire peur : on peut écrire une chanson sur deux octaves, on peut mettre des complexités rythmiques, harmoniques. Après, le pari était que Jérôme rentre dans ma proposition : celle du grand nombre de personnages à jouer. Ce procédé de narration est beaucoup moins évident que ça en a l’air. Et il ne faut pas tomber dans le piège de faire des « voix ». S’il s’agissait de ça, on engagerait Yves Lecoq ou Laurent Gerra ! Il s’agit d’un vrai travail théâtral de comédien, plus complexe que ce qu’on demande ordinairement aux gens de jouer dans ce qu’on appelle le théâtre musical de divertissement. On leur demande de jouer des personnages, pas de prendre en charge un narrateur, de dire des didascalies… J’ai fait le pari que Jérôme allait rentrer dans cette proposition et que ça allait l’amuser. En écrivant ce spectacle, je ne me suis jamais dit : « Ne fais pas ça car ce n’est pas pour ton interprète », ni musicalement, ni textuellement, ni théâtralement.
Ensuite, quand on travaille à l’élaboration des scènes, je n’arrive pas avec un matériel figé, qui doit s’imposer aux gens, comme le font souvent les Anglo-Saxons, où le matériel est très bétonné en amont et où on attend des codes de jeu très précis des comédiens. Pour nous, c’était plutôt un va-et-vient, un ping-pong entre le metteur en scène, le concepteur et les interprètes. Donc, c’est doublement du cousu main, parce que c’est d’abord écrit pour eux, et ça s’est ensuite élaboré avec eux.