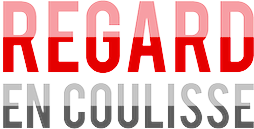Nous avions constaté que les femmes étaient totalement absentes de l'essai de Jéléry Opéra rock : mensonges et vérités. Oubli involontaire, vérité vérifiée ou mensonge déguisé ? Nous ne sommes guère étonnés. De tout temps, les compositrices, surtout talentueuses, ont été écartées de la mémoire collective. C'est chose connue et dénoncée dans le domaine de la musique classique, et ce n'est que tardivement qu'on a fini par redonner la place qui leur revient à Alma Mahler, Clara Schumann, Pauline Viardot... S'agissant d'un genre comme le rock, avec tout ce qu'il peut sous-entendre de démesure et d'excès, de voix rocailleuse et de guitare cassée, on se dit qu'il est plutôt l'apanage du genre masculin.

Pourtant, il y a Kate Bush. L'auteure-compositrice-interprète débute sa carrière professionnelle en 1978 sous l'éminent parrainage de David Gilmour des Pink Floyd. Autour d'elle se forme une équipe de fidèles, dont le batteur Stuart Elliott, qui joue avec les Alan Parsons Project, Paul McCartney... Autant dire qu'elle joue déjà dans la cour des très grands.
Au-delà de la musique et des mots qui lui sont naturels et familiers depuis le plus jeune âge, elle exprime très tôt son désir d'intégrer d'autres disciplines pour aboutir à une forme plus spectaculaire. Elle se forme alors, dès ses premiers albums, à la danse et au mime. Nombre de ses apparitions dans des émissions de télévision, mises en scène avec beaucoup de recherche, témoignent de sa volonté de s'éloigner de la simple restitution musicale et d'accéder à une forme d'art total. En somme, elle est déjà un Maritie et Gilbert Carpentier Show à elle toute seule, un gros grain de folie british en plus ! Il n'y a qu'à revoir cette version de « Babooshka » pour la BBC en 1980 :
ou cette version de « Violin » :

Son Tour of Life de 1979 témoigne d'une scénarisation sophistiquée dans la façon d'offrir sur scène les chansons de ses deux premiers albums, The Kick Inside et Lionheart. Tout dans cette tournée s'apparente au théâtre musical : le découpage en actes séparés par des interludes ; l'ordre dans lequel les titres se succèdent ; la variété des accompagnements (du simple piano à une formation de rock, en passant par l'ajout des mandolines !) ; les multiples costumes et accessoires visant à caractériser les personnages incarnés par l'artiste, d'où les interludes pour laisser du temps aux changements ; la présence d'un magicien ; les projections vidéo ; l'occupation et les réorganisations de la scène ; la présence de danseurs qui s'intègrent à l'action, les chorégraphies variées et la pantomime ; la diffusion de bruits enregistrés ; les jeux de lumières, et des torches aussi ; la récitation de poèmes, de dialogues... On l'aura compris : les Madonna et les Mylène Farmer qui viendront quelques années plus tard n'ont rien inventé ni n'en feront jamais autant ! Évidemment, c'est Kate elle-même qui a tout imaginé, tout conçu ! Car, comme toutes les rock stars de son envergure, tous les créateurs de ce niveau, elle délègue peu et tient à tout contrôler, plus par exigence avec soi que par souci de son image. Elle ressort épuisée de ces vingt-neuf performances européennes (Angleterre, Écosse, Allemagne, France, Suède, Pays-Bas) réparties sur six semaines seulement, à tel point qu'elle renoncera à remonter sur scène avant... 2014 !
C'est aussi à l'occasion de cette tournée d'avril-mai 1979 qu'elle devient, dit-on, la première artiste à utiliser un micro-casque sans fil. Confectionné sur mesure à son intention pour être utilisé sur certains morceaux, il lui offre une liberté de mouvement propice à la théâtralité et à la danse que lui interdit le micro-main – Jéléry insiste à plusieurs reprises dans son essai Opéra rock : mensonges et vérités sur cet objet qui fige l'artiste dans une posture et empêche de faire d'un concert de rock un spectacle de théâtre au sens traditionnel.

Le style musical de Kate Bush est, dans ses premières années de carrière, à la fois déjà très personnel et influencé par David Bowie et Pink Floyd ; et le rock y a une belle part : qu'on en juge avec son « James and the Cold Gun » en concert. On navigue entre « art rock », « pop rock » et « art pop ». Comme beaucoup d'artistes du milieu londonien, elle maîtrise de nombreux langages musicaux, compose des ballades et s'inspire aussi beaucoup de la musique folklorique. À l'occasion de son travail avec Peter Gabriel, elle découvre le synthétiseur Fairlight CMI qui lui permet d'étendre sa palette sonore. En 1982, passé les premières années à suivre la tendance, quoiqu'avec sa propre identité et ses propres expérimentations, elle concrétise avec son surprenant album The Dreaming ses recherches dans de nouvelles formes rythmiques et mélodiques qui puisent dans une primitivité tribale.
Sa voix cristalline et ses notes aiguës de ses débuts – qui l'ont fait remarquer dans son premier single, Wuthering Heights – confèrent à Kate Bush un caractère singulier, énigmatique, immédiatement reconnaissable, lyrique et, disons-le, étrange : une raison de plus d'y voir un rapprochement avec l'appellation « opéra rock », synthèse entre une démesure vocale et une audace déjantée.

Les paroles de ses chansons, là aussi très recherchées d'un point de vue de la langue et qui abordent des sujets souvent inédits parce que délicats, intimes ou satiriques, présentent souvent une richesse qui préfigure le développement d'un livret. À l'échelle de temps d'une chanson, ses textes ne manquent jamais d'installer durablement une ambiance et de livrer une histoire concise mais originale et pleine de sens, à mille lieues des rengaines commerciales. Et, contrairement aux nombreuses rock stars citées par Jéléry qui se sont tournées vers une scénarisation de leurs concerts – il le note lui-même avec désarroi – , Kate Bush ne tombe jamais dans le cliché égo-maniaco-écolo-psychanalytico-suicidaire ! Rien que sur le Tour of Life, elle parle, certes, d'un état dépressif mais qui peut s'estomper avec le sexe (« Symphony in Blue ») ; convoque des films d'horreur et des fantômes mais avec beaucoup de second degré (« Hammer Horror ») ; célèbre la pureté de la danse en hommage à son professeur (« Moving ») ou, avec beaucoup d'ironie, la célébrité médiatique (« Wow ») ; se place du point de vue de l'enfant (l'apprentissage dans « Them Heavy People », la relation aux parents dans « In Search of Peter Pan ») ; loue l'intimité heureuse mais secrète (« Kashka from Baghdad ») ; revisite un grand classique de la littérature britannique (« Wuthering Heights ») ; et aborde des sujets typiquement féminins (la maternité dans « Room for the Life », le cycle menstruel dans « Strange Phenomena »)...

En 1985, elle sort un 33 tours qui lui apporte la consécration, Hounds of Love, dont la face B, sous-titrée The Ninth Wave, constitue à elle seule un concept album : une suite autour du thème d'une femme en train de dériver et de se noyer dans la mer.
En 1993 paraît l'album The Red Shoes. Peu importe qu'elle se soit entourée de Prince et d'Eric Clapton sur certains titres : l'important n'est pas là. S'inspirant de ces fameux Chaussons rouges – le très faustien conte d'Andersen adapté avec maestria au cinéma par Michael Powell et Emeric Pressburger –, elle réalise un film d'une quarantaine de minutes intitulé The Line, the Cross and the Curve qui reprend les chansons de l'album en les scénarisant, en les reliant. Elle ajoute des transitions et des dialogues. Au générique, on trouve l'actrice Miranda Richardson et le chorégraphe-mime Lindsay Kemp – auprès de qui Bush s'était formée au début de sa carrière.
En 2005, elle offre à son fidèle public, qui n'avait pas eu de nouvelles de son idole depuis 1993 mais a qui a bien fait d'attendre, un double-album intitulé Aerial qui s'articule en deux parties : A Sea of Honey et A Sky of Honey. Là encore, des concepts...
L'année 2011 marque la sortie de 50 Words for Snow : que des chansons qui parlent de neige – les Esquimaux ont en effet cinquante mots pour la désigner ! Autant dire qu'elle repousse pour de bon les limites de l'album concept !
 Et en 2014, Kate Bush remonte enfin sur scène, au Hammersmith Apollo de Londres, pour 22 concerts seulement en résidence : Before the Dawn crée l'événement. Plutôt que d'aligner à la queue leu leu ses succès des trente-six dernières années, elle évite la majorité de ses albums – aucun extrait des quatre premiers – et se concentre sur la narration, car elle veut continuer de créer, de raconter. Pour cela, en deux actes, elle puise dans les concepts précités : A Sky of Honey (2005) et The Ninth Wave (1985).
Et en 2014, Kate Bush remonte enfin sur scène, au Hammersmith Apollo de Londres, pour 22 concerts seulement en résidence : Before the Dawn crée l'événement. Plutôt que d'aligner à la queue leu leu ses succès des trente-six dernières années, elle évite la majorité de ses albums – aucun extrait des quatre premiers – et se concentre sur la narration, car elle veut continuer de créer, de raconter. Pour cela, en deux actes, elle puise dans les concepts précités : A Sky of Honey (2005) et The Ninth Wave (1985).
 Côté musique, on est toujours dans le « art rock » et la pop, mais globalement assagi : les mélodies sur plusieurs octaves et les rythmes hyper-saccadés des débuts ne font pas partie du programme bâti par l'artiste qui vient d'avoir 56 ans. L'instrumentarium reste typique de son univers : guitares, claviers, batterie, percussions, mais aussi bouzouki, charango, cornemuse irlandaise. Et puis, bien entendu : des comédiens, des danseurs, des mimes, des marionnettes, des masques, des projections, des animations 3D, un illusionniste... Développant le thème qu'elle avait imaginé en 1985 de cette femme à la dérive, elle côtoie un peuple de poissons – les « Fish People », qui est aussi le nom du label qu'elle a créé en 2011 –, et elle s'est filmée flottant dans un réservoir vêtue un gilet de sauvetage :
Côté musique, on est toujours dans le « art rock » et la pop, mais globalement assagi : les mélodies sur plusieurs octaves et les rythmes hyper-saccadés des débuts ne font pas partie du programme bâti par l'artiste qui vient d'avoir 56 ans. L'instrumentarium reste typique de son univers : guitares, claviers, batterie, percussions, mais aussi bouzouki, charango, cornemuse irlandaise. Et puis, bien entendu : des comédiens, des danseurs, des mimes, des marionnettes, des masques, des projections, des animations 3D, un illusionniste... Développant le thème qu'elle avait imaginé en 1985 de cette femme à la dérive, elle côtoie un peuple de poissons – les « Fish People », qui est aussi le nom du label qu'elle a créé en 2011 –, et elle s'est filmée flottant dans un réservoir vêtue un gilet de sauvetage :
Son navire a coulé. Parfois inconsciente, parfois éveillée, parfois sous l'eau, parfois hors, elle divague, sort de son corps, imagine sa famille sans elle, puis entrant dans l'atmosphère terrestre, elle finit par être sauvée. Survivante, elle goûte d'une façon nouvelle l'amour et la vie. Dans la seconde partie, elle réapparaît en femme-oiseau...
Les nombreux fans, surtout ceux qui n'ont pu être présents lors de cette série limitée de concerts, dont les billets se sont arrachés en quelques minutes, espéraient – espèrent toujours – la sortie d'un DVD. Mais l'artiste, qui avait interdit les photos et les vidéos pendant les concerts, a préféré publier un... triple-CD ! Maigre consolation pour l'aficionado qui, au passage, n'a que faire de savoir si sa déesse préférée a contribué au genre de l'opéra rock ou non. Tout ce qu'il sait, c'est que Kate Bush a toujours été et demeure une icône inclassable qui ne cherche qu'à créer.