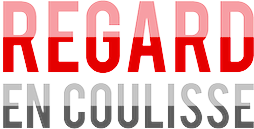Lorsque minuit sonne, les gitanes se réunissent autour du feu pour lire le destin de leurs amours dans les arcanes du tarot. Parmi elles, la ténébreuse Candelas est rongée par la jalousie et le chagrin. Pour reconquérir son amant perdu, elle a recours aux sortilèges ancestraux de son peuple et aux incantations de la magie noire. De l’autre côté du monde, bien au-delà des Pyrénées et des Alpes, un paysan morave encore innocent tente en vain de résister au charme magnétique d’une jeune tsigane. Le souvenir de leur première étreinte devient une obsession. Ses journées aux champs ne sont plus qu’une longue attente qui s’achève à la nuit tombée dans les bras de celle qu’il aime mais dont tout le village se méfie.
Écrits à la fin de la Première Guerre mondiale de part et d’autre de l’Europe, les chants envoûtants de L’Amour sorcier (1915) et du Journal d’un disparu (1921) témoignent des fantasmes qui entourent dans les arts la figure de la gitane, amoureuse libre et passionnée, forcément mystérieuse et un peu magicienne. Le metteur en scène américain Daniel Fish les réunit dans un seul et même spectacle, avec la complicité du chorégraphe Manuel Liñán et d’Arthur Lavandier qui offre une nouvelle orchestration au cycle de Janáček.
Notre avis : Les Tsiganes sont à l’honneur un peu partout dans Strasbourg. Découvrir leur culture, réfléchir sur la façon dont le regard est porté sur eux, participent de l’intérêt de cette opération. En réunissant deux œuvres courtes en un seul programme, l’Opéra du Rhin permet aux spectateurs de se plonger dans cet univers tantôt âpre, tantôt chatoyant. Leoš Janáček et Manuel de Falla ont tous deux composé leurs œuvres à la même période. Si leurs musiques diffèrent, les rassembler ainsi prend tout son sens. Encore une question de regard.

Celui du metteur en scène new-yorkais Daniel Fish – qui fut récompensé par un Tony Award pour sa mise en scène de Oklahoma! en 2019 – est particulièrement tranché, provoquant rejet ou forte adhésion. Nous penchons plutôt pour la seconde. L’idée principale, maline, est de proposer une mise en scène quasi identique pour les deux œuvres. L’attention du spectateur, qui comprend vite le dispositif, s’en trouve immédiatement titillée. Le piège serait de tomber dans le syndrome du « jeu des sept erreurs » et de débusquer chaque détail différent. Mais nous en sommes loin, tant les partis pris sont forts et semblent partagés par toute l’équipe qui entoure le metteur en scène. Ils contraignent le spectateur d’aller au-delà et l’invitent à entrer dans cet univers. Tout est tranché, tranchant, dans la mise en scène.

Trois couleurs agressives constituent la base du décor, des chaises pour seuls éléments de décor, aucune envie d’entrer dans une illustration des textes, mais la possibilité pour tout spectateur de ressentir avec intensité ce qui nous est montré avec une certaine impétuosité. Car Manuel Liñan et sa troupe de danseurs savent parfaitement provoquer des sensations contrastées, aidés en cela par des costumes évolutifs – la robe espagnole et son châle ne sont pas oubliés, mais les danseurs les revêtent à vue. Nous avons évoqué les couleurs agressives du décor, les projections vidéo le sont tout autant : sans transition, le plateau devient écran sur lequel des images d’un coq, qui sera mis à mort, viennent brutaliser le récit. Une délicieuse dichotomie s’installe entre cette brutalité et la direction, très suave, de l’orchestre et des chœurs par Łukasz Borowicz. Une réussite.