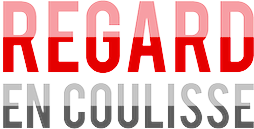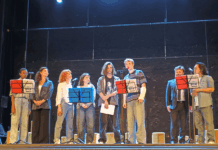Revenons d’abord à vos débuts. Quel est votre parcours ?
Arrivée à Paris à 18 ans, j’ai intégré l’institut Rick Odums, et leur cursus Comédie Musicale – Perfoming Art. À l’issue de ma première année, j’ai tout de suite été engagée sur la tournée asiatique du Petit Prince de Richard Cocciante et suis partie quatre mois en Asie. Ce premier contrat m’a pratiquement tout appris. J’ai terminé ma deuxième année, enchaînant avec Les Misérables à Lausanne en 2009. Dès lors, les contrats se sont succédé. J’ai ensuite principalement travaillé en province, dans des cabarets, ou au Marsoullan – les prémices de Double D. En 2012, j’ai été engagée sur Sister Act à Mogador puis ce furent évidemment La Belle et la Bête, Le Bal des vampires, Jules Verne, et il devait y avoir le Fantôme… (Le spectacle n’a pas vu le jour en raison d’un incendie à Mogador, N.D.L.R.)
Mes deux dernières années à Paris, j’étais également professeure de technique vocale au Studio international Vanina Mareschal, à l’EPCM et à l’AICOM.
Votre nom est indéniablement associé à Mogador…
Il faut savoir une chose : les mauvaises langues disent qu’une fois rentré dans cette maison, tu peux y rester toute ta vie, c’est totalement faux. Pour une raison simple : ce n’est jamais la production française ou Stage France qui sélectionne les artistes. À chaque fois, des créatifs étrangers viennent auditionner et choisir les rôles. Stage France n’a pas son mot à dire. Ainsi, pour Sister Act, une équipe hollandaise est venue caster, pour La Belle et la Bête, ce furent des Américains, pour le Bal, des Allemands, et pour le Fantôme, l’équipe de Broadway. Comme tout le monde, j’ai passé les auditions. Et d’ailleurs, je n’ai pas été prise dans Cats, malgré ma candidature (rires) !
Vous évoquiez le Fantôme, est-ce un sujet tabou ?
Pas du tout. Cela restera une expérience assez incroyable. Je touchais du doigt le rêve qu’était ce show pour moi. Certes, il y a eu la déception de ne pas obtenir le rôle de Christine et surtout de l’annulation, mais aussi l’immense cadeau de rencontrer mon idole absolue : Sierra Boggess, dont je devais être la doublure. La découvrir, la voir travailler fut formidable. Elle est devenue, depuis, une de mes amies, qui compte énormément pour moi. J’ajoute un immense regret : que la merveilleuse adaptation de Nicolas Engel n’ait pas été dévoilée. C’est terrible car elle est sublime.
 Et vous êtes partie à Londres…
Et vous êtes partie à Londres…
J’ai emménagé il y a deux ans, presque jour pour jour, en juin 2019. Après dix ans à Paris, j’avais besoin d’ouvrir mon champ d’horizon et de me challenger. Pour être heureuse, il me faut de l’adrénaline, de l’extraordinaire dans ma vie ! Je fantasmais l’idée d’avoir tout à prouver à nouveau, et de sauter dans l’inconnu. C’est très facile de se conforter dans ce qu’on a fait, de se reposer sur ses acquis. Moi j’ai besoin d’aller de l’avant. Je ne suis pas seulement celle qui a joué Belle (rires). Ce qui compte pour moi n’est pas ce que j’ai fait, mais ce qui m’attend.
Lorsque j’ai choisi de partir, je n’avais aucune certitude sur mon avenir. J’ai pris la décision totalement dans le vide. Entre mon préavis et mon départ, la production de Londres m’a appelée et j’ai obtenu le Fantôme. Les planètes s’alignaient, me confortant dans mon choix. Je suis arrivée en Angleterre le 20 juin 2019, le Fantôme débutait le 12 août. Le temps de m’installer, c’était parti !
Sans connaitre personne ?
Absolument personne ! Voilà bien un challenge qui me plaisait. Je me suis retrouvée au milieu d’une vaste troupe de 38 personnes, avec la barrière de la langue, de la culture... Il y avait des jours difficiles ou j’étais un peu perdue, je ne saisissais pas toujours les blagues, j’étais totalement décalée, mais petit à petit, j’en ai fait une force. Être différente par ma culture.
Justement, comment vous êtes-vous préparée ?
J’avais un anglais très approximatif. Je comprenais la langue – à Mogador, on était souvent dirigés en anglais. Mais de là à le parler couramment et à jouer, c’était autre chose ! Avant de partir, j’ai pris des cours intensifs avec un coach britannique. Le reste s’est fait en étant immergée et en travaillant avec des profs de dialecte.
 Pourquoi vous ont-ils choisie ?
Pourquoi vous ont-ils choisie ?
J’imagine que ce qui a fait la différence est, sans doute, ma technique classique. J’ai pris des cours de lyrique toute ma jeunesse, même une fois arrivée à Paris. Lors des auditions, j’étais une des seules à arriver avec à la fois un background de comédie musicale et cette technique classique nécessaire pour le Fantôme.
Et le Covid est arrivé… Que s’est-il passé pour vous ?
Nous avons joué de août 2019 jusqu’au 16 mars 2020. Comme en France, tout s’est arrêté brusquement pour les raisons que l’on sait. Je me suis retrouvée clouée chez moi, sans activité, bloquée à l’étranger et loin de ma famille…
Mais surtout, il s’est passé un épisode incroyable : en juin 2020, en plein confinement, la production a annoncé la fin du show et a licencié tout le monde. Tous corps de métiers confondus, artistes, costumiers, techniciens... Ça a été terrible. Des gens qui œuvraient sur le spectacle depuis la création, depuis 34 ans, ont été congédiés du jour au lendemain. Cela a provoqué un tollé ici. Mon monde s’est effondré. J’avais l’impression de vivre un cauchemar, après l’épisode parisien... Il y avait un côté malédiction du Fantôme. En fait, au-delà des raisons financières, il y avait la volonté de Cameron Mackintosh de recréer le show avec des énergies nouvelles, une nouvelle direction, des changements au niveau des décors, une nouvelle distribution... Sur le moment, ça a été un gros coup dur.
En janvier dernier, il y a eu un nouveau casting. J’ai ré-auditionné et j’ai été réengagée. Mais, des 38 artistes de la troupe précédente, nous ne sommes que deux à avoir été repris !

Vous reprenez le même rôle ?
Oui. Je suis dans l’ensemble et je suis deuxième doublure de Carlotta. Cette hiérarchie est extrêmement respectée, c’est même une règle contractuelle. Je ne joue le rôle que si la titulaire et la première doublure sont indisponibles. La grosse difficulté réside dans le fait que ce n’est que de la dernière minute ! On ne le sait jamais à l’avance. Lors de mon premier contrat, j’ai interprété Carlotta seize représentations en trois mois. En l’apprenant quelques heures avant, parfois l’après-midi même. Encore un autre défi !
 Quelles différences voyez-vous entre jouer à Londres et jouer en France ?
Quelles différences voyez-vous entre jouer à Londres et jouer en France ?
La plus grosse différence peut-être, liée évidemment à la culture anglo-saxonne, tient au rythme. Par exemple, c’est normal, ici, de faire huit représentations par semaine. C’est normal de rester des années, parfois des décennies, sur un même show. Ce qui est totalement inimaginable en France. Au bout d’un an, les artistes sont contents de changer, d’aller vers autre chose. On ressent beaucoup moins cette lassitude ici.
Par ailleurs, le public est là. Les Anglais vont aussi facilement au théâtre qu’au cinéma. Malgré le coût, n’importe quelle famille londonienne va aller régulièrement voir une comédie musicale. En France, les gens privilégient le fait de partir lors des vacances scolaires. Le budget famille n’est pas du tout utilisé de la même manière.
Et sur la façon de travailler ?
On retrouve dans les deux pays avantages et inconvénients. Il y a, à Londres, une forte exigence de travail personnel. Ainsi, on a eu deux jours pour déchiffrer tout le spectacle, et dès le troisième jour, il fallait être sans partition ; à Paris, on ne sera pas sans livret avant dix ou quinze jours de répétitions, quitte à rabâcher. On va beaucoup plus détricoter en France, on va aller plus en profondeur et partager davantage. Cette différence de culture dans la méthodologie de travail m’a beaucoup frappée.
Jouer le Fantôme après ce qui s’est passé à Mogador, est-ce une revanche ? Un clin d’œil ?
C’est un plaisir ! L’aboutissement de quelque chose qui n’a pas vu le jour à Paris. Je ressens beaucoup de fierté, mais rien de revanchard. Si je n’avais pas vécu tout ce que j’ai vécu en France, je ne serais pas capable de faire le Fantôme ici. Je suis pleine de reconnaissance par rapport à tout ce que j’ai appris et connu à Paris.
 Finalement, de tout cela, qu’est ce qui a été le plus difficile en arrivant ?
Finalement, de tout cela, qu’est ce qui a été le plus difficile en arrivant ?
J’ai un vrai problème : je me sens constamment illégitime. Mon gros complexe lorsque je suis arrivée est que je voulais, à tout prix, faire oublier le fait que j’étais française. J’avais peur qu’on dise que j’avais pris la place d’une Anglaise : « La p'tite Frenchie, elle ferait mieux de rentrer chez elle. » J’ai mis du temps à lâcher prise. Maintenant je le revendique ! Je suis très fière. C’est un bonheur de retrouver la scène dans quelques jours. D’autant que mon mari (le pianiste Antoine Mérand, N.D.L.R.) va travailler avec moi sur le Fantôme, comme musicien et doublure chef d’orchestre.
Je profite avant de nouvelles aventures. Elles seront peut-être françaises, je compte bien rejouer en France un jour, vous me manquez !