Après un tremblement de terre survenu à Los Angeles en janvier 1994 (d'une magnitude de 6,7 sur l’échelle de Richter – pas le Big One mais quand même...), le compositeur John Adams et sa librettiste June Jordan dressent à partir des témoignages de sept victimes une fresque de la société contemporaine. L’élément fondateur, le chaos sismique, sert de bascule pour raconter l’avant, l’après, mais aussi les interactions de classe (l’épicentre du séisme se trouvait dans une banlieue pauvre) et, surtout, l’amour. La compagnie belge Khroma, constituée autour d’Enrico Brignoli et de Marianne Pousseur, se lance avec ferveur sur un plateau coloré et nu dans un Broadway des décombres.
Notre avis : Quelque vingt-sept ans après la création française à la MC93 de Bobigny et douze ans après la production du Châtelet, il était temps de faire redécouvrir au public parisien – elle était à l'affiche à Lyon pas plus tard qu'en 2020 – cette œuvre de 1995 formellement et musicalement atypique qui parle d’amour sur fond d’injustice envers les plus démunis.
« Je regardais le plafond et soudain j'ai vu le ciel », témoignait une survivante du séisme de 1994. À la manière d'un film choral, sept individus errent dans un paysage urbain que vient détruire un tremblement de terre.. Leurs relations, compliquées avant l’événement, se transforment et trouvent une issue après. La narration prend la forme d'une succession de numéros entièrement chantés qui traduisent les émotions ou l’action du moment, évoquent le passé ou décrivent des rêves – plus dans la veine d’un opéra rock que d’une comédie musicale traditionnelle. Le style « minimaliste répétitif » cher au compositeur John Adams adhère au long d’une partition sophistiquée mais abordable qui incorpore également toute une palette de genres – rock, pop, ballade, jazz, soul, blues rap... – et se singularise par un instrumentarium plutôt inattendu – synthétiseurs, guitares électriques, saxophone, percussions...

De chanson en chanson, on suit l’évolution des personnages confrontés à leurs troubles intimes, leurs désirs inassouvis. La nature elliptique du livret de June Jordan et la structure en numéros indépendants représentent indéniablement un défi pour la mise en scène : comment donner de la substance à des personnages sans dialogues qui n’existent que le temps de quelques chansons ; comment relier des instants que la musique tient à distance ? Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli ont choisi de faire le noir après chaque numéro. Leur scénographie repose sur des projections vidéo des détails d'une maquette qui donnent à voir, en grandeur nature sur le fond de scène, des décors de l’histoire : la rue, les murs du tribunal, le bureau du planning familial... Le choix d’habiller ainsi la scène s'avère plutôt payant dans certains tableaux – l'altercation filmée en direct par la journaliste, la virée dans la voiture de police où s'opère une séduction très convaincante –, mais s'essouffle en seconde partie par manque de réalisme ou de poésie et ne traduit que partiellement la touffeur du livret et quasiment pas sa force de contestation. Et pourquoi la maquette est-elle à vue du public, sur scène ? mystère.

Le livret original décrit précisément les personnages par leur métier ou leur état – un policier, une journaliste, un avocat, un repris de justice, une assistance sociale, un pasteur, une immigrée sans papier – mais aussi par leurs origines ethniques : ce sont des archétypes qui sous-tendent un engagement politique. Par conséquent, même sans tomber dans un wokisme malvenu ni être à cheval sur l’adéquation du physique des comédiens à ceux des personnages, on s’interroge tout de même sur le décalage qui peut s’ensuivre lorsqu'une inscription projetée pendant le prologue censée éclairer le public sur le contenu du livret indique « asiatique » ou « noir » pour désigner des artistes manifestement blancs. On se demande aussi s’il n'était pas incongru de transformer l’avocat du livret original en une avocate, cette modification conduisant à introduire une touche saphique qui vient inutilement compliquer la relation entre la journaliste et le policier précisément au moment où celle-là fait avouer à celui-ci qu’il est gay !

Mais le plus dommageable, même quand on ne connaît pas l'ouvrage a priori, ce sont les trop nombreuses coupes : au moins sept numéros sur les vingt-trois d’origine ont disparu ! Même si elle est définie par son créateur comme un songplay (une pièce en chansons), on ne saurait considérer l'œuvre comme une playlist d’où l’on piocherait à son gré tel ou tel titre. Qu’il y ait des contraintes artistiques ou de production derrière cette mutilation, c’est compréhensible ; que ce ne soit pas mentionné dans les outils de communication, c’est inexcusable et irrespectueux. Non seulement on spolie le public de passages musicaux particulièrement entraînants qui l'auraient enchanté, mais surtout, dans ces conditions, plusieurs personnages peinent à exister ou perdent beaucoup en épaisseur : le pasteur, privé de son sermon sur les belles femmes et de ses duos, se retrouve à jouer les utilités – et c'est bien dommage étant donné la qualité vocale de la seule intervention qui lui reste ; le prisonnier n'a plus l'occasion d'exprimer ses nobles désirs d'avenir ; l'immigrée clandestine salvadorienne, sans son magnifique air où elle exprime son mal du pays et son choix d'y retourner pour y défendre la démocratie, a bien du mal à nous convaincre du bienfondé de sa rupture avec le malfrat dont elle est pourtant amoureuse...
Ces réserves mises à part, on salue la mise en place soignée d’une œuvre peu aisée du point de vue du rythme et des harmonies. Même si on regrette parfois un manque de volume et de projection, surtout en début de soirée, – n'aurait-il pas fallu sonoriser ? –, les artistes lyriques issus du conservatoire royal de Bruxelles font preuve d’un bel engagement et de voix sensuelles qui servent avec chaleur les styles variés convoqués par la partition, jusqu'au dernier numéro choral qui reprend l'entêtante chanson-titre en passant par un trio coquin, des solos introspectifs ou séducteurs, des duos intimes... L’ambiance très particulière créée par une musique à la fois complexe, subtile et captivante à laquelle rendent justice musiciens et chanteurs justifie la découverte de cette œuvre fascinante et inclassable, hélas tronquée, qu'on a envie de défendre. On se réjouit qu'après avoir été annulé lors du premier confinement, ce spectacle puisse être enfin vu.
Pour en savoir plus sur la genèse et le contenu de I Was Looking at the Ceiling and then I Saw the Sky, voir notre dossier complet.
Un reportage de France Musique réalisé au cours des dernières répétitions.
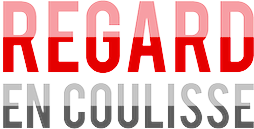

























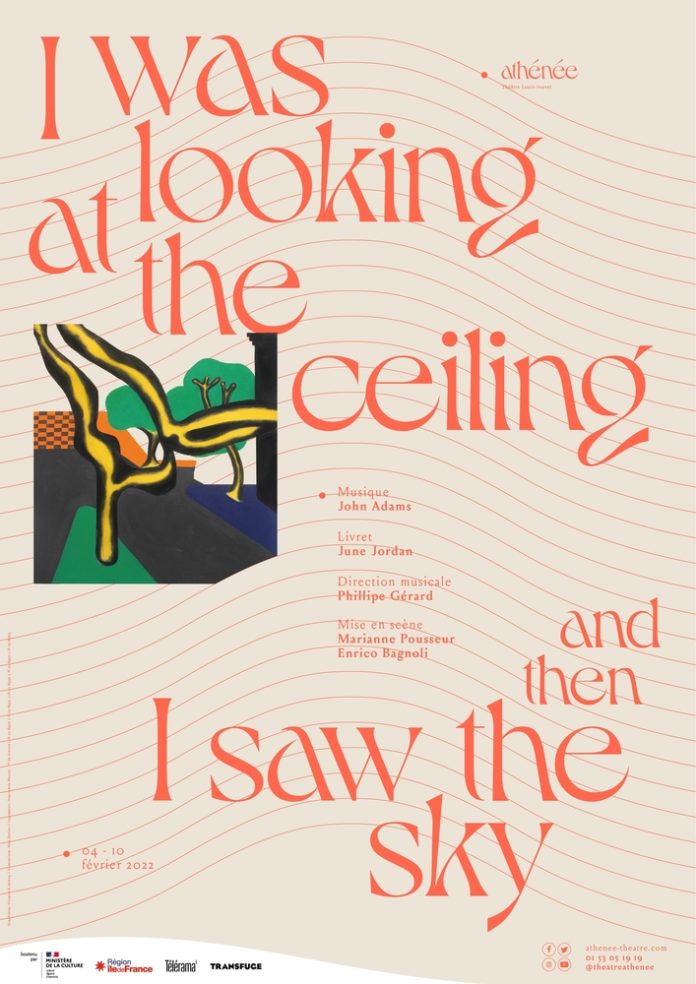

Critique pertinente : on regrette également ces coupes multiple, et pour le plaisir de les entendre, et pour la compréhension de l’œuvre… vraiment dommage.