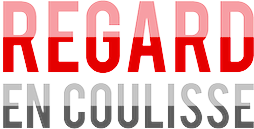Brecht et Weill en Louisiane. Sur l’éternelle trame de la jeune fille innocente que la société va corrompre, Brecht et Kurt Weill proposaient en 1933 une variation aussi neuve que grinçante qui allait devenir un classique. Voici l’héroïne devenue deux sœurs… « Poussée par Anna 1, Anna 2 évite chacun des péchés pour en commettre d’autres bien plus monstrueux avec la bénédiction de tous », résume le metteur en scène Jacques Osinski. C’est à la jeune mezzo-soprano Natalie Pérez qu’il a confié ce double rôle, dans un roadtrip au Mississippi qui est aussi le récit « du rêve et des compromissions auxquelles on cède pour l’atteindre », et qui n’a aujourd’hui rien perdu de son insolence et de son mordant.

Notre avis : Quel bonheur ! Quel immense bonheur de retrouver le chemin des théâtres ! Renouer, enfin, avec le spectacle vivant, se laisser immerger à nouveau dans le son qui surgit depuis la fosse d’orchestre, sentir les visages et les corps de chair et de sang des artistes à portée de main, et s’abreuver ensemble de culture et d’émotions.
Comme souvent, l’Athénée met à l’affiche une œuvre qui sort des sentiers battus en puisant dans le registre grinçant. On se souvient, dans des nuances différentes, du Testament de la tante Caroline, des Enfants terribles, de The Importance of Being Earnest…
Les Sept Péchés capitaux, créé au moment où Weill s’arrête à Paris avant de poursuivre son exil, s’inscrit dans la lignée des deux œuvres précédemment composées avec Brecht : L’Opéra de quat’ sous et Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny. On y retrouve une critique acerbe de la société de consommation capitaliste et de la déshumanisation de la société sur une musique expressionniste qui explore les dissonances et s’appuie sur des formes connues pour mieux les déformer. Encadrés d’un prologue et un épilogue, sept tableaux passent en revue un à un les péchés capitaux de la religion catholique en mettant en situation deux sœurs toutes deux prénommées Anna – à moins que ce ne soient les deux facettes d’une même jeune femme – parties chercher fortune sur les routes des États-Unis. Après s’être adonnées à tous les vices avec plus ou moins de bonne conscience, elles finissent par rentrer chez elles, en Louisiane, où les attendent leur famille – un père, une mère et deux frères –, qui commente à distance la déchéance progressive et certaine des demoiselles.

Conçue comme un « ballet chanté » à numéros, l’œuvre pose au moins deux questions au metteur en scène. Quelle place accorder sur scène à chacune des deux Anna (la chanteuse et la danseuse) ? Et comment installer une narration de bout en bout qui donne de la cohérence à l’ensemble ? Jacques Osinski a opté pour une présence sur le même plan des deux Anna, faisant même danser – de façon convaincante et à plusieurs reprises – la chanteuse. Mais l’aspect décousu du livret demeure irrésolu : on passe d’un péché à l’autre sans transition vraiment convaincante. L’ajout ici et là de trois mélodies en français composées par Weill lors de son exil à Paris – La Complainte de la Seine, Je ne t’aime pas et Youkali – vient étoffer l’atmosphère sans l’enrichir vraiment. Quoique sur des thèmes musicaux magnifiques et sur des paroles à vous faire dresser les poils, et même si on a énormément de plaisir à les entendre – Youkali avec orchestre dans un arrangement d'Arthur Ouvrard, quel cadeau ! –, elles distendent encore un peu plus le fil narratif de la soirée.
Le dépouillement du décor – un échafaudage de métal au centre, une table à manger au fond pour la famille, un vestiaire à cour pour les changements des Anna – ne constitue pas un handicap tant il souligne le caractère urbain et progressiste de l’œuvre. En revanche, l’utilisation de la vidéo qui défile au-dessus du cadre de l’action pour, semble-t-il, habiller et animer la scène se révèle peu convaincant. Car, en dépit de qualités irréfutables – leurs rythmes, leurs couleurs, leurs variations, leur pouvoir d’illustration, leur humour même… –, les images attirent inévitablement le regard, comme pour l’empêcher de se poser sur les deux actrices principales, dont on aurait aimé qu’elles soient parfois dirigées de façon plus fouillée, leurs intentions plus poussées, les manifestations de leur âme plus exacerbées.

Car les protagonistes s’accordent déjà magnifiquement bien. Avec un joli timbre clair et sans effort, une articulation parfaite et sa stature, Nathalie Pérez campe à merveille une sœur aînée sournoise et manipulatrice, qui n’a pas besoin de hausser le ton ou de grossir sa voix pour pousser au vice l’autre Anna – la danseuse Noémie Ettlin –, plus naïve, plus prompte à être la victime, mais plus à fleur de peau, et dont la résistance voudrait s'exprimer.
Le quatuor d’hommes – oui, la mère est chantée par une basse ! –, que Weill utilise à la manière d'un chœur antique, incarne très justement, habillé comme des Deschiens, cette famille de bons à rien hypocrites.
Dans sa réduction pour quinze musiciens et portée par l’orchestre de chambre Pelléas et son chef Benjamin Levy, la musique de Weill ne perd rien de son ironie, de sa noirceur, de son tranchant, de sa force à bousculer, de son espoir vibrant, de sa grandeur à s’imposer. On la reçoit comme un électrochoc, comme une décharge de réanimation, comme le rappel de notre présence retrouvée dans une salle de théâtre. Car la culture, le spectacle vivant, a pour vertu capitale de nous réveiller et d'aiguiser notre capacité à y voir clair. Pour cela, merci !