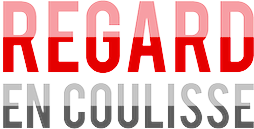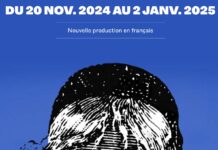Elle a enchanté le concert de la 42e rue du 2 décembre 2019 avec une interprétation bouleversante d’un titre inédit de Michel Legrand, « I Haven’t Thought of This in Quite a While », titre qui figure sur la réédition de l’album Legrand Affair. Elle sera à nouveau invitée par Laurent Valière pour programmer l’émission 42e rue du 19 janvier prochain.
Rencontre avec une diva sans fard, tout aussi capable d’incarner Eliza Doolitle que de rédiger un brillant article sur la misogynie dans le théâtre musical pour le New York Times que… de sauver un homme dans le métro à New York !
Quel est votre parcours ?
J’ai eu une enfance avant le show business, mais à partir du moment où je me suis lancée, à 12 ans, ce fut comme une religion. Pour vous parler de mes racines, ma famille est venue aux États-Unis pour fuir la misère de leur Italie natale vers 1917. J’ai grandi avec ces histoires de vie difficile et d’Amérique comme terre de tous les possibles. Du côté de ma mère, l’histoire est très colorée puisque ma grand-tante a été repérée par Florenz Ziegfeld et a intégré les Ziegfeld Follies. Ma grand-mère était belle et dotée d’une voix remarquable. Elle serait bien devenue chanteuse, mais elle a rencontré un Italien qui l’a obligée à mettre fin à son métier, ce qui est arrivé également à ma grand-tante d’une autre manière. Ces figures tutélaires aux destins contrariés m’ont influencée, c’est certain. Tous les costumes, les bijoux, les affiches, les autographes de cette époque étaient consignés dans la maison où j’ai grandi.

Ma mère a rencontré mon père, encore un Italien, un pianiste de concert. Il me racontait que, à 4 ans, il dormait sous le piano tellement il voulait être concertiste. C’était un prodige. Il a toutefois étudié la médecine à Yale, de peur de ne pouvoir vivre de son talent. Autant dire que dans mon environnement l’art était partout, mais que personne n’avait véritablement franchi le pas. Mes grands-parents ont connu la Dépression, la Seconde Guerre mondiale, et mon père celle du Viêt Nam. L’art nous a toujours permis dans la famille de nous évader. Dans les années 70, quand j’étais enfant, mon père jouait de nombreux compositeurs, dont Michel Legrand qu’il adorait. D’ailleurs lorsqu’il joue « The Summer Knows », je sais que ce titre le ramène, avec ma mère, à des émotions très fortes. J’ai eu une enfance heureuse. Mon père est devenu un médecin réputé. J’adorais la gymnastique, j’étais douée. A 12 ans, j’étais vraiment la fille yankee de base, mais quasiment dotée d’un corps de femme, ce qui était ennuyeux pour la gymnastique. Ma mère m’a emmenée en août dans un « theater camp », une sorte de colonie de vacances où des spectacles étaient montés. On m’a tout de suite attribué les rôles de filles sexy, comme Hedi Larue dans How to Succeed in Business Without Really Trying. Tout le monde riait, j’adorais amuser la galerie et, grâce à la gym, je savais bouger.
Vous avez 12 ans, votre âge pivot, donc… Avez-vous travaillé immédiatement ?
Pour mon anniversaire, ma mère m’a emmenée voir la reprise de On Your Toes que j’ai tant adoré que j’en ai pleuré ! J’ai demandé à ma mère : « Qui sont ces gens et comment sont-ils arrivés là ? » Je voulais savoir car je voulais faire partie de cette famille d’artistes. Intuitivement, à 12 ans je savais que j’étais destinée à cela, même si cela peut paraître bizarre. Une communauté rigolarde, mais aussi disciplinée, belle, assez folle. Impossible de l’expliquer, mais je le ressentais très fortement. J’étais toutefois trop jeune pour me lancer. Je connais la valeur des choses et les sacrifices nécessaires pour arriver à ce que l’on veut. Mes parents, ou dirais-je ma famille italienne avec tous ces excès, me l’ont appris. Travailler dur ne m’a jamais effrayée. Après tout, je me sens parfois comme une immigrée qui doit faire ses preuves. La frustration artistique ressentie par des membres de ma famille a été fondamentale : elle m’a poussée de l’avant. D’ailleurs, mon père a toujours été d’accord pour me payer des livres et des cours, mais pas des vêtements ou des salons de coiffure.
Comment êtes-vous arrivée à Broadway ?
Assez rapidement en fait, ça a tenu du miracle… Tout s’est mis en place lorsque j’ai fréquenté French Woods, un célèbre « summer camp » américain spécialisé dans le spectacle. En trois semaines, j’ai appris Evita, Barnum, Guys and Dolls… Cela m’a tellement plu que j’y suis retournée plusieurs années de suite. En trois ou quatre étés, je commençais à être vraiment au point sur une dizaine de spectacles, sans parler de ceux que l’on faisait à l’école. J’apprenais sans cesse et j’essayais d’aller voir des spectacles. À cette époque, j’ai découvert Chorus Line, un musical qui m’a marquée, car il montrait ces gens aux univers tellement différents réunis par la même passion : celle de la scène. Il m’a, en quelque sorte, donné la permission, la légitimité de rejoindre la famille de l’« entertainment ». Dans ce camp d’été, j’ai trouvé un agent. Il m’a permis de débuter à la télévision dans un spin off des Muppets : The Great Space Coaster. Puis j’ai joué dans des soaps de-ci de-là. Je précise que je n’étais autorisée à travailler ainsi que si mes notes étaient excellentes au lycée ! C’était le cas et j’ai intégré l’université de Yale directement en deuxième année ; j’y ai étudié comme une folle pendant plus d’un an. J’en suis fière, j’ai tellement appris. Les choses sérieuses ont alors débuté, puisque j’ai participé à She Loves Me, et j’ai été repérée pour jouer Cosette dans Les Misérables pour la tournée nationale. Tout était comme à Broadway, c’était une expérience incroyable, j’avais 18 ans, rendez-vous compte ! Je suis partie pendant un an et demi, et je suis rentrée pour passer mes examens (j’étudiais par correspondance). J’ai bossé dur. Quand j’ai quitté le spectacle pour retourner à Yale, la production, qui pensait que j’étais folle, m’a fait faire une boîte remplie de matériel scolaire, tout à l’effigie des Miz. À Yale, j’ai dû me concentrer, reprendre une autre vie. Ensuite, je suis allée à Oxford étudier Shakespeare durant l’été. Puis j’ai voyagé, j’adore les îles grecques. Je me sens presque plus grecque qu’italienne finalement. J’aime la vie simple là-bas.
Par la suite, comment les choses se sont-elles enchaînées ?
Après Yale, j’ai passé de nombreuses auditions, j’ai joué Anna Karenina, mais à Broadway ils m’ont donné le rôle de l’ingénue, considérant que j’étais trop jeune pour le rôle-titre, que j’avais pourtant interprété en tournée ! Le spectacle était bon. J’avais 22 ans. Ensuite, j’ai incarné Eliza dans une version très moderne de My Fair Lady qui défendait un point de vue assez féministe, considéré comme un peu trop d’avant-garde. L’intrigue se termine de manière plus engagée : Eliza s’en va, elle prend son envol. C’était radical, et cela n’a pas plu. Le metteur en scène, un génie, refusait que ce soit un conte de fée. Le spectacle était intelligent, en avance sur son temps. J’en ai parlé dans le New York Times, puisque j’écris divers articles pour ce journal. À cette époque, tout allait comme sur des roulettes pour moi. C’est plus tard que j’ai dû batailler…
Comment se sont dirigés vos choix ?
J’avais beaucoup d’opportunités à cette époque et je devais faire des choix. Same Cole était mon agent, il était le numéro un. Il a refusé que je fasse The Sound of Music. Donc nous avons porté notre choix sur High Society, qui fit un four. J’ai pris cet échec trop au sérieux. On a tellement envie que les gens aiment le spectacle dans lequel on est. J’ai ensuite joué dans Amour, l’adaptation américaine du Passe-muraille, à l’occasion de quoi j’ai pu côtoyer Michel Legrand. Puis j’ai joué dans Dracula dont Christopher Hampton, le scénariste de l’adaptation filmée des Liaisons dangereuses, a écrit le livret. Mais là encore, ce ne fut pas un grand succès. Toutefois, durant ces années, j’ai travaillé sans cesse. Un bon souvenir reste Sunday in the Park with George en 2002 au Kennedy Center. Et si j’ai participé à de nombreux spectacles, je n’ai jamais été bloquée par un rôle pendant cinq ans, même si j’aurais bien aimé ! Par ailleurs, mon médecin m’a avertie : je voulais fonder une famille et le temps filait. Il était temps pour moi d’envisager sérieusement cet aspect plus personnel. Je n’avais bien entendu pas envie d’arrêter le spectacle, mais d’être vraiment là où on avait besoin de moi. Une carrière vaut-elle le coup, au point de faire une croix sur tout le reste ? Victoria, ma première fille, est arrivée — quelle joie ! — et j’ai voulu un autre enfant, que j’ai perdu pendant la grossesse. Ce fut un choc. Je me trouvais tiraillée, comme beaucoup d’actrices, entre mon désir de redevenir mère et celui de reprendre ma carrière. Par miracle, nous devions par la suite avoir des jumelles. Le jour où je l’ai appris est le plus beau jour de ma vie.
Vous avez donc à ce moment privilégié votre vie privée ?
Je suis devenue comme un témoin de la vie, sans prétendre rien contrôler, plutôt que quelqu’un qui agit. Les gens me demandent comment je fais : mes enfants n’ont jamais été une difficulté à gérer, juste une source de joie. Mes filles sont mon énergie, elles me portent. Ce que le show business apporte, ce n’est que du bonus. En 2017, on m’a découvert une tumeur. J’ai subi de nombreuses opérations et me suis dit : « Si nous écrivions une lettre à tous les amoureux du théâtre, quelle serait-elle ? » C’est ainsi que j’ai eu l’idée de Sondheim Sublime, qui est devenue un CD, en partant de titres comme « Children and Art », « Not While I’m Around », « Loving You »… J’y ai également intégré « Sooner or Later » pour répondre à mon tempérament italien et sexy ! Ces chansons contiennent mes peurs. J’avais aussi en tête Sunday in the Park with George, cette réflexion définitive sur l’art, et la lutte entre l’amour concret et l’art. Voilà ma vie… Mais rassurez-vous, concernant cette tumeur, les derniers résultats sont rassurants : ce n’est pas un cancer, mais quelque chose que l’on identifie dans le sang et qui se soigne.
Vous semblez attachée à Stephen Sondheim ?
C’est un auteur-compositeur que j’adore. J’ai présenté mon spectacle sur lui un peu partout. Peu à peu, il s’est transformé en quelque chose d’autre, comme une quête spirituelle. Les gens rient, apprennent des choses parce que j’ai un auteur hors pair qui m’a fait connaître un concept juif, qui dit que deux âmes sont à l’intérieur de nous : l’une occupée aux tâches à accomplir et l’autre dédiée aux désirs. Bien entendu, elles se combattent sans cesse. Cette dualité tient du « sublime », d’où le titre… Une Italienne catholique qui s’empare de la culture juive, bien plus nuancée, c’est un peu inattendu, mais ces recherches et découvertes me passionnent. C’est comme entrer dans un nouveau monde. Intégrer des éléments intellectuels dans un spectacle de cabaret, cela a de quoi surprendre… J’aime tellement ça et le public également !
Parlez-nous de votre relation avec Michel Legrand…
Je l’aimais tellement, ce fut une rencontre très forte. Sa mort m’attriste, mais pour lui rendre hommage, je veux être drôle car il l’était. Les concerts à sa mémoire ces mois derniers étaient légers, pleins de vie, à son image. Tant de courants musicaux sont passés en lui que cela m’a donné une idée pour le dernier cabaret, que j’ai joué voilà deux semaines. Je le débute avec un extrait de High Society, soit « I Love Paris », car, pour moi, Cole Porter aurait adoré que Michel Legrand arrange sa musique ! Par la suite, je remets ce compositeur dans le contexte de la chanson traditionnelle française, soit la chanson d’amour dont l’origine remonte au Moyen Âge… Le public est pour le moins étonné. Et j’aime chanter « L’Âme des poètes » de Trenet, car cette chanson résume si bien l’état d’esprit de ce musicien. À la fin, on a bien plus qu’un hommage à Michel Legrand : un voyage dans la culture française qui me fascine tant.
Et cet album que vous ressortez aujourd’hui ?
Tout cela est parti du succès surprise de l’album Sondheim Sublime et de l’article hommage que j’ai écrit dans le New York Times à l’occasion de la disparition de Michel Legrand. La maison de disque, touchée par ma prose, m’a suggéré de ressortir l’album Legrand Affair datant de 2011. J’ai proposé de l’agrémenter de séances de travail effectuées avec Michel sur les chansons accompagnées par le percussionniste Steve Gad, qui m’a autorisée à utiliser ces enregistrements. C’est intéressant, car cela permet de comprendre comment il réfléchit et travaille. Mon intérêt est de partager un peu plus l’art de Legrand. J’avais également différents titres non retenus dans l’album original. Et ce titre inédit que Marilyn et Alan Bergman m’ont confié. Ils m’ont également informée que Michel aurait aimé que j’enregistre « Little Boy Lost », alors je l’ai fait, à mes frais. C’est vraiment un hommage que je rends à cet immense artiste et, encore aujourd’hui, je lui suis reconnaissante de m’avoir tant appris. Et j’espère que cet album touchera le public français. Il faudra bien que je revienne vous voir pour jouer ici mon spectacle autour de lui. Vous m’invitez ?
Pour aller plus loin :
- la page du disque Legrand Affair, contenant une session inédite de travail entre le compositeur et la diva ;
- le site très complet de Melissa Errico.